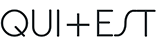Observateur attentif de notre environnement visuel, Clément Santos a entrepris une sorte d’ʺinventaireʺ des signes visuels et notamment des logotypes qui envahissent notre quotidien réel et virtuel. Il se les réapproprie, les déconstruit, leur ôte toute signification commerciale ou politique, et s’attache à composer des variations formelles ou des « sculptures anonymes » en deux dimensions ou dans l’espace. Diplômé de l’École supérieur d’Art et de Design de Valence (2014), Clément Santos présente ces dernières œuvres à la galerie la Villa Balthazar à l’occasion de l’exposition 321 avec Mallory Parriaux et Georges Gas.
Auteurs :
Clément Santos / Q+E
CS – De manière générale, c’est le signe qui m’intéresse, le signe visuel, la forme visuelle qui fait sens, et dans ces signes, le logo plus particulièrement. Je vais récolter ces formes, ces logos dans mon quotidien, sur les affiches, les véhicules, les vêtements, internet… Ce sont souvent les logos de grandes marques qui m’intéressent, pour la charge significative et émotionnelle qu’ils portent. Ma démarche est justement de transformer ces signes là en œuvres concrètes – d’où ma référence à l’art concret. Je réalise à partir de ces signes des sculptures, des peintures, des collages qui n’existent plus pour signifier, mais pour être regardés, voire appréciés pour ce qu’ils sont.

NCN, acrylique sur médium, 46 x 82 x 2,8 cm, 2020 © C. Santos
Dans la nature, les choses existent déjà en elles-mêmes. Une feuille, un nuage, un caillou… Les détourner ne pourrait pas les rendre plus réelles. Ce qui m’intéresse dans les signes, et plus particulièrement les logos, c’est justement qu’ils n’existent pas pour eux-mêmes. Ils sont créés avant tout pour représenter/incarner quelque chose d’autre. S’ils sont autant présents dans notre environnement, réel ou numérique, c’est qu’ils répondent à une fonction. Ce qui m’intéresse, c’est d’utiliser ces formes-là pour créer des objets justement autonomes, sans fonction, à regarder pour ce qu’ils sont concrètement.
Il y a donc une dimension symbolique dans ce geste. Comme une invitation à regarder ce qui nous fait réellement face, et prendre conscience de cette interprétation qui vient de glisser entre nous et le réel. Je cherche donc autant à créer des œuvres à apprécier pour ce qu’elles sont esthétiquement, qu’à exprimer/témoigner cette envie de contact plus direct avec le réel.
CS – Oui il y a une part critique dans mon travail. En choisissant de reprendre des logos de grandes marques, je cherche à questionner l’influence du marketing sur notre perception du réel justement. Une paire de chaussures n’a pas la même valeur, et ne sera pas perçue de la même manière, suivant le logo posé dessus. C’est ce qu’ont compris les grandes entreprises dans les années 90, dont Nike est la meilleure représentation : Il est plus intéressant de se concentrer sur la création d’une « mythologie » de la marque, plutôt que sur le produit en lui-même. Il suffit alors d’associer cette mythologie au produit. Parce que ce qui est acheté, c’est finalement moins le produit en lui-même que ce qu’il représente, ce qu’il incarne. Et le logo dans tout ça, est ce qui fait ce lien entre cette mythologie et le produit réel. Il est d’abord en bas des affiches, à la fin des publicités, au bord des stades, et se retrouve enfin sur le produit réel. Cette quantité de signes, d’images et d’informations auquels on fait face au quotidien, que le marketing produit, vient donc comme ajouter des filtres entre nous et le réel.
CS – Le volume est vraiment ce vers quoi je tends. Il y a cette envie de sortir de l’image, d’aller vers des réalisations dans l’espace qui engagent le corps, la matière, le toucher. J’ai réalisé trois grandes pièces pour le moment. Ça engage d’autres techniques ; il y en a une en acier, composée de trois grands modules noirs, une autre en bois, en contreplaqué très fin. Je n’ai pas un attachement particulier à un matériau ou à une technique. C’est l’idée qui va m’amener à utiliser telle technique ou tel matériau. Par exemple, je viens de commencer à travailler avec le papier pour des collages, qui sont présentés dans la galerie : c’est une nouvelle piste.
Je cherche à ce que ce soit physique, palpable, qu’il y est un corps : une image projetée ne m’intéresse pas. Les premiers tableaux que j’ai pu réaliser étaient sur toile, avec ma forme dessinée au milieu, centrée ; je créais en réalité de nouvelles images. J’ai désormais l’envie de donner une plus grande présence à mes pièces.

Pajero, acrylique sur aluminium, 200 x 200 x 200 cm, 2012 © C. Santos

Airbnb, acrylique sur acier, 50 x 45 x 55, 2021 © C. Santos

Dadasi, acrylique sur bois, 150x 150 x 170 cm, 2012 © C. Santos
CS – Je cite souvent un extrait du manifeste de l’art concret « Un élément pictural n’a pas d’autre signification que lui-même », en conséquence un tableau n’a pas d’autre signification que « lui-même ». L’idée qui m’intéresse ici est évidemment ce contact direct avec le réel. « Ce que vous voyez est ce que vous voyez », dit autrement Frank Stella. L’œuvre est à apprécier pour elle-même, et c’est là tout son sens.
CS – Des textes de Théo van Doesburg, fondateur de l’art concret, m’ont marqué, mais ce sont surtout des artistes à partir des années 50 qui m’ont vraiment inspiré, comme François Morellet, Ellsworth Kelly, Alan Charlton, ou encore Gottfried Honegger qui a créé l’espace d’Art Concret à Mouans-Sartoux. Pour des raisons différentes, chacun de ces artistes m’a touché : François Morellet pour la rigueur de ses œuvres, le jeu, la dérision, la légèreté, le potentiel du hasard ; Gottfried Honegger par son engagement sur l’éducation au regard, le sens qu’il donne à l’art dans la société ; Alan Charlton pour la présence de ses œuvres dans l’espace.
Depuis la fin de l’Ecole d’art, je me confronte à la réalité économique et c’est difficile de trouver à la fois du temps pour créer, et questionner ce que je fais. J’aimerais avoir un confort de vie qui me permette de prendre un peu de recul, comme ce que permet cet interview qui m’a encouragé à me poser, à questionner où j’en étais, à écrire, à aller au-delà de ce qui peut être au quotidien de l’ordre de l’intuition. Je me nourris aujourd’hui plus de découvertes sur internet, par Instagram beaucoup, d’artistes contemporains connus ou moins connus. Je suis plus inspiré et nourri de formes visuelles que d’approches théoriques ou historiques en ce moment.
CS – Je pense que mon travail s’inscrit dans l’art contemporain dans la mesure où les formes que j’utilise, les logos, proviennent de notre environnement actuel, et que j’exprime des questionnements personnels liés à notre époque. L’aspect formel de mon travail est plus intemporel lui. Il rappelle des formes plus anciennes, de l’époque moderne par exemple. Et ces formes-là existeront encore et encore.
Beaucoup d’autres artistes utilisent des signes ou des logos aujourd’hui. Je pense à Francis Baudevin, Hugo Schüwer Boss, Claude Closky… On en trouve aussi dans le Street art, qui jouent sur le détournement. Je me suis aussi nourri d’artistes plus conceptuels, qui questionnent d’une manière ou d’une autre notre perception du réel : Joseph Kosuth, Bertrand Lavier, Daniel Buren… Et d’autres encore, de styles très différents, mais dont je me sens proche des questionnements : Marina Abramovic, Fabienne Verdier, Felice Varini…
Souvent je me suis demandé si je ne pouvais pas me libérer du signe, pour créer des œuvres plus « légères », totalement conçues par moi-même, me concentrer sur l’aspect formel. Mais à chaque fois, je ressens qu’il me manquerait quelque chose. Et de la même manière, si j’exprimais seulement mes questionnements plus personnels, quelque chose me manquerait aussi : le plaisir, le jeu, la matière… Je continue d’interroger ma pratique, mais je sens avoir trouvé dans la peinture, la sculpture, la recherche plastique, ma manière d’exprimer, de créer des expériences sensibles et esthétiques qui puissent aussi nous questionner.
Entrevue réalisée le 27 octobre 2021, Beaumont-les-Valence

Exposition 321, galerie la Villa Balthazar, Valence, 2021 © M. Parriaux