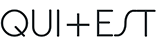Auteurs :
Christophe Gonnet / Q+E
C. G. – Je dois revenir sur la diversité et la complexité de ces notions, de ces échelles aussi, ou de ces points de vue (de regards, de pensées) que sont : le paysage, la nature, les milieux, le site, le végétal ou l’animal… : il y a tout un enchainement de notions et d’objets qui coexistent dans mon travail.
Une pièce très importante pour moi fût Le jardin qui tombe (ill. 1), que j’ai réitéré au travers de diverses installations à partir d’unités de terre. C’était un peu la suite des parcellisations : créer un espace monumental par la multiplicité de petits gestes, de petites unités constructives. Le pot constituait alors cette unité. La terre était moulée à l’intérieur, le pot devenait parfois le socle de celle-ci. En ensemençant ces unités, un jardin apparaissait légèrement, s’élevait, en même temps que la terre dans laquelle il se développait, s’effondrait. La terre étant sortie d’elle-même, c’était un jardin qui se construisait sur sa propre ruine, sur son propre effondrement. C’était un jardin voué à l’échec au sens traditionnel du jardin, mais qui réussissait quelque chose du point de vue de l’art.

1 – Le jardin qui tombe, Lycée René Descartes, Saint-Genis Laval, 2001 ; 650 pots, terre végétale, semences diverses, micro-asperseur © C. Gonnet

1 – Le jardin qui tombe, Lycée René Descartes, Saint-Genis Laval, 2001 (détail) © C. Gonnet
La nature, c’est toute l’histoire de notre évolution humaine… L’histoire de l’humanité s’est construite dans sa relation à la nature, mais c’est finalement l’histoire d’une contre-nature, puisque c’est cela qui nous a permis de nous extraire aussi singulièrement de notre condition première, d’une manière si différente par rapport au reste du monde l’animal – et ça commence dès la bipédie. On a contrarié notre corps pour changer notre relation à l’espace et notre capacité d’agir. Pour moi l’essentiel de l’histoire de l’humanité est cette évolution dite préhistorique… le reste est « un détail ». Je suis persuadé que les problèmes auxquels l’humanité va devoir se confronter dans le futur, peuvent trouver des réponses dans cette mémoire-là, qui est bien-sûr globalement perdue, mais au moins peut-on faire l’effort de la considérer, de l’interroger malgré tout.

2 – Le jardin qui tombe 2, Lycée horticole, Romans, 2007 ; plantes diverses, terreau, fer à béton, irrigation par goutte à goutte, 13 installations différentes de dimensions variables © C. Gonnet

2 – Le jardin qui tombe 2, Lycée horticole, Romans, 2007 ; plantes diverses, terreau, fer à béton, irrigation par goutte à goutte, 13 installations différentes de dimensions variables © C. Gonnet
C. G. – J’ai toujours essayé de voyager, ou j’ai toujours essayé de multiplier mes destinations de voyage en utilisant la sculpture comme véhicule. Partir d’un site, d’un arbre ou d’une plante, c’est déjà définir un peu les modalités et la nature d’un voyage. Pour moi la sculpture, c’est une façon de se mettre en mouvement, de se mettre dans une forme de déplacement mental mais aussi physique. Pour répondre à la question plus précisément, je crois très certainement que nos corps et de fait nos esprits qui y sont embarqués, n’ont cessé de muter (de gagner, en apparence, mais de perdre, en réalité) et de perdre en capacité de perception de ce qu’est réellement la diversité du monde… ou de la nature…Si le monde est devenu si minuscule, s’il s’est tellement appauvri, c’est d’abord parce que nous avons oublié ou perdu tous nos outils de perception de sa diversité. Je nous ressens comme de soudains aveugles apeurés dans un magasin de porcelaine bondé, et nous précipitant pour trouver la sortie ! Nous allons trop vite pour percevoir la réalité !
Dans beaucoup de mes travaux j’essaie de reconsidérer les modalités d’approches de l’espace, en agissant sur le temps de nos perceptions. Le plus souvent je pars de l’idée qu’en changeant sa posture, la façon dont on se tourne, s’assoit, s’allonge, se déplace, le rythme qu’on met en place avec le lieu, on réouvre ou révèle des choses qu’on a oubliées ou qu’on ne peut pas voire autrement qu’avec lenteur. Le même lieu, qu’on le traverse ou que l’on s’y arrête, n’est plus le même lieu. Un même espace peut être beaucoup d’espaces différents pour peu qu’on change des éléments, des données… Par ailleurs, j’ai toujours travaillé hors sol : toutes mes œuvres ont un lien avec la suspension, une forme de détachement du sol. C’est une manière d’être dans le lieu tout en y étant pas tout à fait.
Nos derniers soubresauts de retour, ou de recherche d’espaces naturels, ne sont en réalité que l’expression de notre désespoir de ne plus appartenir à la nature… A partir de 2001, dans le cadre d’une résidence en Australie, j’ai commencé de développer le Lit d’arbre (ill. 3), une forme d’instrument qui met en relation l’arbre et le corps dans une position d’équilibre pacifique, la tête contre le tronc.

3 – Lit d’arbre, as you make your bed, so you rise. comme on fait son lit, on s’élève, Angleterre 2001 ; acier, bois © C. Gonnet

3 – Lit d’arbre, les environnementales; Tecomah; 2006; acier, bois © C. Gonnet
Pour évoquer un autre exemple, en 2012, j’ai été très impressionné par l’évènement de Felix Baumgartner (*) – nom que l’on pourrait traduire par : arboriculteur ! – qui a réalisé ce saut record en chute libre depuis la stratosphère. Ce fût véritablement pour moi l’illustration d’une fin, d’un échec de tout notre progrès. Voir cet homme monter au ralenti vers l’espace pour finalement s’arrêter au seuil de notre atmosphère terrestre et faire cet acte complètement suicidaire – se jeter en chute libre pour retomber sur terre avec une grande incertitude de réussite… une sorte d’Icare de notre modernité.
Pour conclure, la question du temps est très importante pour moi, et j’aime la résumer par ce titre que je donne à une sorte de press-book que je mets à jour régulièrement : L’étendue paysage / Les temps du paysage. Cette phrase, qui mêle ces deux interprétations à l’orale, dit que le paysage est à la fois une étendue d’espace et une étendue de temps. Le paysage, c’est une infinité de temps concomitants (celui de chaque animal, de chaque végétal, de chaque homme…) mais c’est aussi une forme d’empilement de temps, par stratification.
C. G. – Pas du tout… ma matière première, ce sont les lieux et le temps pour les comprendre, le reste n’est que moyens ou outils. Je me suis toujours méfié des objets, de leur détournement… sans doute parce que je rencontre certaines difficultés avec l’addition de formes, d’usages, de matières dont je ne maîtrise pas l’origine. Mais bon, ce n’est pas une posture absolue… sans doute cela m’est arrivé comme pour Jardinières et autres ménagères mais il s’agissait d’une œuvre dans l’espace urbain… donc dans un espace lui-même ʺartificielʺ ou ready-made.
J’ai fabriqué cette montagne d’objets et l’ai installée hors sol sur des fers à béton. Je me suis aperçu plus tard que j’avais finalement produit une sorte de maquette d’un espace urbain, d’une ville, avec son système racinaire de ferraillages dans le sol d’où sortent des bâtiments et des interstices d’espaces plantés (ill. 5).

5 – Jardinières et autres ménagères, Lyon, 2006 ; meubles et appareils électroménagers usagés, terreau, plantes diverses, irrigation par goutte à goutte, fer à béton © C. Gonnet