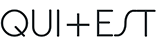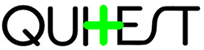Les œuvres in situ de Christophe Gonnet s’inscrivent respectueusement dans le paysage sans rechercher de rapport de domination ; il s’agit pour lui de s’immerger dans un milieu, de s’ouvrir à la contemplation de ce qui l’entoure, d’en apprécier la singularité : l’intimité d’un sous-bois, la densité d’une forêt, l’humidité d’un sol marécageux… Des passerelles, des entourages, des cheminements, des poses… sont imaginés et fabriqués par l’artiste qui intervient seul ou en collaboration avec d’autres – paysagistes, architectes, etc. – dans de nombreux sites au sein de résidences, de commandes publiques ou privées, notamment dans le cadre du projet des « Routes sublimes du Vercors ». Dans ce second article, Christophe Gonnet aborde plus particulièrement les processus de création et de production, le statut de l’œuvre d’art et de l’artiste.
Auteur: Q+E
Entretien avec
Christophe Gonnet
C.G – Le fait d’être artiste, en appartenance à une communauté sociale, culturelle, économique… nous conduit immanquablement à être conscient de la dimension politique de nos actes. Reste que pour moi, cette dimension politique doit être davantage une question de responsabilité qu’une question de posture. La seule véritable trace que l’humanité soit réellement en train de laisser, c’est celle consécutive à l’apparition de ce que les scientifiques appellent l’ère anthropocènique ! Est-ce une trace ou une tache monumentale ? Je ne cultive aucune position revendicative sur cette question… j’ai peut-être simplement, naïvement ou humblement, toujours essayé de réaliser des choses tant à l’échelle du temps qu’à celle des espaces qui sont à ma mesure.
La sculpture m’accompagne, m’aide à augmenter mon sentiment d’existence, mais j’essaie de ne jamais tomber dans l’illusion qu’elle puisse m’aider à tromper la mort… Les premières sculptures durables de l’histoire sont apparues avec la pratique des rites funéraires et permettaient d’offrir aux corps une éternité qu’ils n’ont pas. Cette dimension-là a habité l’histoire de la sculpture et l’habite encore. Pour ma part j’ai conscience que mes œuvres vivent avec moi, et disparaitront avec moi – ou ont leur propre vie, mais somme toute assez limitée. On a si peu de temps pour se sentir vivant, et tellement de temps pour réaliser le fait d’être mort ! Pour moi la sculpture aiguise le moment présent, le fait d’être présent, de sentir tout ce qui existe autour de moi.
En revanche, j’évite le mot ʺéphémèreʺ qui me semble du côté de l’évènement, du spectacle peut-être et je préfère celui de ʺtemporaireʺ. Mes Parcellisations étaient infiniment fragiles et il m’a fallu du temps pour assumer leur fragilité. Je l’ai assumée quand j’ai compris qu’une pièce tombée n’était pas morte, elle avait temporairement disparu, et j’ai mis en place un processus pour la faire réapparaître (ill. 1, 2).

1 – Parcellisation 4, Espace Vallès, Saint-Martin d’Hères, 1995 ; argile crue, branches d’abricotier © C. Gonnet

2 – Erre n° 2, Exposition « D’une rive à l’autre » avec l’artiste Marion Orfila, Usine Utopik, centre d’art à Tessy-sur-Vire, 2013 ; schiste de Tessy-sur-Vire, 100 verres à pied différents, 100 chevrons 10 x 10 cm de peuplier © C. Gonnet
C. G. – J’ai aujourd’hui tant d’exemples différents, de projets, de sites, de commandes qui ont plus ou moins prédéterminé la place ou la nature de mes projets, qu’il est difficile de répondre d’une façon affirmative d’une posture ou d’un choix… Mais globalement, la question du site importe peu…. Je veux dire par là qu’il n’y a jamais de site idéal (ou alors c’est le plus souvent ʺpiégeuxʺ) … Ce qui est important, c’est le temps et les moyens que l’on construit pour apprendre à voir, lire, comprendre le lieu où l’on se trouve…
Globalement, et avec beaucoup de retenue malgré tout, je ne suis pas sûr d’aspirer à rencontrer de beaux sites naturels. Et puis qu’est-ce qu’un beau site ? Et a fortiori qu’est-ce qu’un site naturel ?… Mais j’aime je crois (ce qui m’arrive le plus souvent) rencontrer des sites à priori un peu quelconques, mal définis, ou difficilement identifiables. Des sites qui recèlent diverses histoires, des abandons, des usages variables… Se construit alors l’histoire d’une adoption réciproque. Je me sens peu à peu accueilli, des petits détails me sont offerts, j’aperçois des coïncidences… bref, je crois que je préfère tomber peu à peu amoureux d’un lieu que de vivre des coups de foudre !
J’ai été très touché par ma rencontre avec Georges Trakas (*)qui intervient sur des lieux blessés et abimés ; lui va réconcilier l’histoire, le lieu, la nature, avec les hommes, et engager un processus de réparation. Moi je ne suis pas sur la réparation mais sur un autre mode de rencontre, une nouvelle façon d’être en présence, d’être ensemble avec le lieu et mes œuvres sont pensées pour disparaître assez simplement.
Ma première expérience in situ eut lieu sur le territoire du Trièves, marqué alors par de grosses mobilisations d’habitants contre un projet d’autoroute. J’ai été invité en 1998-99 par Françoise Pouzache (dans le cadre du projet Artefact et avec l’Association Sous les Tilleuls) qui souhaitait à travers une résidence d’artiste, amener les habitants à se rencontrer et à s’exprimer sur leur paysage. J’ai pris alors le parti « de fuir » les paysages remarquables, et suis allé me perdre dans un coin de forêt assez isolé et sans doute jamais vraiment exploité (la pente y était très abrupte). J’y ai passé du temps, fait des allers-retours et créé un petit chemin ; peu à peu le projet s’est écrit et l’histoire s’est construite : une plateforme ronde dans une forêt de hêtres (ill. 3), en réalité une forme d’inversion des Parcellisations que je produisais à cette période.

3 – Sans titre, Parcelle n°15, forêt domaniale du Petit Veymont, Saint-Michel-les-Portes, 1999 ; bois, acier © C. Gonnet

3 – Sans titre, Parcelle n°15, forêt domaniale du Petit Veymont, Saint-Michel-les-Portes, 1999 ; bois, acier © C. Gonnet
En 2012, dans le cadre d’une résidence d’artistes portée par la Communauté de communes de l’Argentonnais, j’ai été invité à réaliser une œuvre sur un des deux sites « naturels ». Ces sites, aux histoires très différentes (l’un jardin extraordinaire, l’autre pâturage agricole) s’étaient retrouvés délaissés et enfrichés pendant plusieurs dizaines d’années. Ma présence avait pour enjeu d’introduire une réflexion paysagère et artistique avant leur aménagement prochain par une agence de paysage. Les découvrant peu à peu, beaucoup de détails merveilleux me sont apparus ; j’ai finalement conçu une œuvre pour chacun, en élaborant un nouveau système constructif me permettant de dessiner avec mes structures, au fur et à mesure de leur apparition. L’une, Passage (ill. 4), est une ligne à travers bois qui relie la ruine d’un ancien moulin à un énorme rocher en granit sur et au travers duquel ont poussé un frêne et un chêne (tous deux de plus de 200 ans). Ce cheminement long de 100 m. est un voyage aller-retour entre deux histoires, l’une de la nature, toujours en progression, et une autre, humaine et en ruine. Pour l’autre œuvre, située dans le clos de l’oncle Georges, Entourage (ill. 5), j’ai construit un grand cercle, à l’emplacement de jeunes merisiers, pris dans son entourage. Le cœur central devient un petit jardin sauvage, non directement accessible (un jardin dans le jardin !). Seuls deux escaliers en périphérie permettent de monter sur cette plateforme circulaire. Le principe constructif peut évoquer les cernes de l’arbre mais également les ondes de l’eau, la rivière Argentonnais se trouvant toute proche.
J’ai depuis réitéré plusieurs fois ce mode de travail, comme à la ferme de Vernand (en nord Loire) l’été dernier, dans le cadre du programme de résidences artistiques porté par l’association Polyculture. Je traverse là une zone marécageuse, emplacement d’un ancien étang aujourd’hui envasé et totalement couvert de saules et d’aulnes.

4 – Passaage, Passerelle d’Auzay, Argenton les Vallées, Deux-Sèvres, 2012 ; pin autoclave, acacia © C. Gonnet

4 – Passage, Passerelle d’Auzay, Argenton les Vallées, Deux-Sèvres, 2012 ; pin autoclave, acacia © C. Gonnet

5 – Entourage, Clos de l’oncle Georges, Argenton les Vallées, Deux-Sèvres, 2012 ; pin autoclave, acacia © C. Gonnet

5 – Entourage, Clos de l’oncle Georges, Argenton les Vallées, Deux-Sèvres, 2012 (détail) © C. Gonnet
C. G. – C’est difficile de répondre à cela de façon très générale… et puis cela s’est tellement transformé ou dépend beaucoup des situations, du type de projet… Et puis les outils aussi ont considérablement évolué ces dernières années !!! L’outil photographique par exemple, qui est très important et utile pour moi du début à la fin pour la conception, mais au-delà pour conserver une mémoire, étant donné le caractère temporaire de mes œuvres… Les outils informatiques également sont nécessairement importants, même si je favorise toujours la maquette pour projeter.
Je mixe un peu tout cela… Quand je suis sur un projet, il y a toute une phase où je fais sur carnets des petits dessins, plutôt maladroits, mais qui me permettent de mettre en connexion la pensée, le regard et la main. J’ai aussi une pratique du dessin plus autonome, très décalée, avec de tout petits dessins de 5 cm. par 5 cm., par opposition à mes pièces monumentales (ill. 6) ; c’est totalement abstrait, ce sont des utopies de projets, autour du végétal, de l’arbre, de relations de matières. Je ne dessine pas assez je crois, faute de temps, mais j’écris davantage… Écrire, verbaliser m’aident beaucoup ! Même quand on marche dans la nature tout seul et qu’on ne parle pas, le langage est actif, parce qu’on ne voit rien qu’on ne puisse pas lire, et on ne peut rien lire qu’on ne puisse pas nommer. Écrire aide à mettre au jour des pensées qui nous traversent sans le savoir. Je rêve aussi ! Les pensées de nuit, entre deux sommeils, sont très importantes pour moi… et je résous souvent beaucoup de questions ainsi.
C. G. – La production a longtemps été une chose qui me paraissait impossible de déléguer ! Au départ, parce que mes premières œuvres étaient le fruit d’un véritablement entrainement, d’une maîtrise d’équilibres qu’il m’était impossible de partager ! Et puis sans doute aussi quelque chose se jouait toujours entre le drame et la jubilation ! Je pense aux Parcellisations où j’allais à la limite des tensions entre les matières, les équilibres, les possibilités de faire ; comme avec Parcellisation 2 à Art3 à Valence (ill. 7), j’ai cru ne jamais y arriver ; mais ce qui paraissait impossible à un moment se maîtrise dans le temps. Puis lorsque la réalité de l’atelier s’est déplacée vers l’in situ, et bien c’est une question d’intimité… être là avec le travail en train d’apparaître, de se transformer… je ne peux pas transmettre ou déléguer des choses que je ne peux pas anticiper.
Et puis je crois que j’ai beaucoup de mal à répéter et chaque fois que j’ai compris, que j’ai réussi à maîtriser un principe de fabrication, je ne fais que réinventer de nouvelles difficultés. Mais il y a sans doute beaucoup d’artistes qui fonctionnent ainsi. L’art est une pratique qui résonne avec le mythe de Sisyphe… ce n’est pas d’atteindre un résultat qui est important, fusse-t-il « génial » sur le coup, c’est d’accepter l’éternel recommencement et de trouver du sens autant dans les efforts pour y parvenir que dans le désespoir de comprendre qu’il est aussi une forme d’impasse… J’ai compris avec l’expérience que les œuvres réussies représentent forcément aussi une forme d’échec, parce qu’elles ne proposent pas ou difficilement de recommencement. L’art n’est qu’une éternelle variation.

7 – Parcellisation 2, Art 3, Valence, 1993 (détail) © C. Gonnet

7 – Parcellisation 2, Art 3, Valence, 1993 ; paille de seigle, plâtre, acier © C. Gonnet
C. G. – Vaste sujet ! Disons que j’oscille entre deux univers utopiques… un paradis perdu, un autre inaccessible ! Une idée de nature dont l’image se brouille peu à peu, et aujourd’hui on est au cœur de la question de sa disparition ou de mutations comme nous n’en avons jamais eu auparavant ; de la prise de conscience d’une transformation profonde de paradigme. C’est une partie de mon sujet et l’autre, c’est l’aspiration à une communauté humaine qui régresse de tout progrès et qui ne parvient pas à faire humanité. D’un côté notre milieu et de l’autre l’humanité à laquelle on appartient mais qui reste une utopie inaccessible en direction de laquelle on ne cesse d’échouer. En même temps qu’on construit le vivre ensemble, on génère des systèmes d’exclusion.
Peut-être que le choix de l’art, ou de la volonté de l’art, c’est simplement l’acceptation de vivre en conscience d’une utopie de l’existence, de son non-sens. Et cela depuis toujours. Et sans doute est-ce cela qui est le plus difficile. Il n’y a pas de monde ordinaire sans art. Pour moi il n’y a pas de séparation entre le monde ordinaire et celui de l’art. Faire de l’art, c’est faire apparaître et donner du sens à ce qui nous entoure. Sans cela, il n’y a rien ! Je ne suis d’aucun progrès. Je ne crois pas que l’activité artistique – son rôle, sa nécessité, sa valeur – ait subi le moindre progrès depuis 50 000 ou 100 000 ans. Et aujourd’hui je ressens de véritables émotions en découvrant des peintures rupestres.
C. G. –Répondre à cette question, c’est risquer de vouloir s’en justifier… peut-être n’est-ce pas à moi d’y répondre pour ce qui concerne mon travail… Je n’aime pas beaucoup ʺl’idée de génieʺ dans l’art… Je ne crois pas que l’on devienne remarquable ou un grand auteur seul. Toute notre vie est le fruit d’actions collaboratives qui mises bout à bout permettent l’émergence d’un contexte plus ou moins fructueux. Plus le temps passe, plus j’aspire à partager mes temps, mes projets de créations avec d’autres. Ce n’est jamais simple, peut-être rarement une réussite absolue s’agissant de ce qui est produit, mais cela m’offre in fine, des tranches de vie souvent fortes et durables.
C’est devenu presqu’une tarte à la crème que cette citation de Robert Filliou « L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », mais il n’en reste pas moins que l’on n’a jamais mieux défini l’art qu’ainsi. En quelque sorte ne pas vivre pour l’art mais faire de l’art pour vivre. De toute façon, on est seul. Du début à la fin, dans notre existence, comme dans l’art, comme dans toute perception, nous vivons des expériences solitaires… nous ne pouvons vivre que cela ! On ne peut ou on ne doit être dupe de cela… mais pour moi, ce qui est un vrai défi, ce n’est pas d’assumer cette condition, c’est de la partager ou de la confronter aux autres.
J’apprécie maintenant les collaborations, même si je fais moins ce que je veux ; en revanche elles me renvoient encore plus à moi-même : il y a une résistance du fait de travailler avec l’autre qui oblige à se positionner, à dialoguer et bien sûr aussi à faire des concessions. C’est une question ou une forme de défi que j’aime bien me poser aujourd’hui ; c’est une autre maturité du travail que de partager avec d’autres. Avec des architectes, c’est une autre langue, une autre approche de l’espace (ill.8, 9). Et j’accepte volontiers ces collaborations, telle celle avec l’agence lyonnaise d’architecture-urbanisme-paysage BIGBANG pour le projet des « Sublimes routes du Vercors » sur lequel nous travaillons actuellement. Les belvédères que nous avons en charge de concevoir autour du Col de la Bataille, n’ont pas vocation à s’imposer comme de grandes sculptures dans ces paysages déjà époustouflants ! Pour moi, il me semble qu’ils interrogent à nouveau et diversement l’ambiguïté d’une lisière de notre condition, celle de considérer que l’étendue nous appartient, ou accepter que ce soit nous qui lui appartenons.
Entretien C. Gonnet / C. Burgard / 16/02/2022

8 – Sans titre, 1 % culturel du restaurant universitaire de l’UTBM de Sévenans, Territoire de Belfort, 2004 ; acier, tiges filetées inox, carottages béton © C. Gonnet