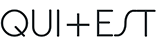Nourri par l’univers du quotidien, de la bande dessinée à la musique rock, Hervé Di Rosa investit le musée de Valence (*) avec 200 œuvres qui dialoguent avec les collections permanentes historiques et contemporaines. Ses peintures sont surtout connues et associées à la Figuration libre, cependant cet artiste revendiquant plutôt les arts modestes a développé une pratique plurielle – moins connue – mêlant arts graphiques, céramique, vannerie… continuellement enrichie au contact d’artisans du monde entier. Philippe Bouchet, commissaire de l’exposition « Hervé Di Rosa. Ses sources, ses démons – ALL-OVER » (*), s’entretient ici avec l’artiste sur sa démarche avec les artisans d’ailleurs, sur la création collective et sur les relations savoir/savoir-faire.
Auteurs :
Philippe Bouchet et Hervé Di Rosa
Hervé Di Rosa : Pierre Restany avait en effet parlé de « la bonté du cœur » dans la préface du catalogue de mon exposition à la galerie Louis Carré en 1994, lors de la présentation de mes peintures sur bois réalisées au Ghana – où j’ai appris les techniques de peinture d’enseignes africaines. Néanmoins, je ne pense pas être plus généreux qu’un autre. Je dirai même que je suis aussi mégalo et égocentrique, et que j’essaye de me soigner ! Je suis convaincu que tous les artistes sans exception défendent quelque chose et le mettent au-dessus de tout. Mon idée est plutôt de prendre en compte des productions, des techniques des artistes et des artisans d’ailleurs. On ne peut que s’en enrichir, l’art occidental s’est toujours nourri des autres cultures. Néanmoins, le travail que je fais n’a rien à voir avec la générosité, il est plutôt ancré dans une réalité, convaincu que je suis de la nécessité d’utiliser ce que le monde génère, toutes les images produites, dans leur diversité et leur richesse. Les œuvres réalisées au cours de mes étapes autour du monde tendent en quelque sorte à devenir collectives.
H. Di R. : C’est assez simple : je le vois comme un échange de savoir et de savoir-faire, à l’exact opposé du monde tout de même très unilatéral dans lequel nous vivons. Ce sont toujours les mêmes qui donnent, toujours les mêmes qui prennent, surtout dans l’art me semble-t-il ! Plus que tout, ce qui m’intéresse, c’est le changement permanent, la surprise qui intervient dans mon œuvre. Plus jeune, alors que j’utilisais des matériaux bruts, que je faisais beaucoup de monotypes, de linogravures, de peintures, j’avais le sentiment de ne plus arriver à laisser quelque liberté que ce soit à la matière. Je me suis beaucoup interrogé avant de réaliser que la liberté pouvait être amenée, certes par de nouvelles pratiques de ma part, mais surtout par la main de l’autre. C’est en ce sens que je parle de surprise, quand la main de l’artisan intervient dans mon travail, qu’elle lui insuffle son énergie. J’aime aussi l’idée qu’il puisse s’emparer de mon inspiration en la réinterprétant. Ce n’est pas toujours le cas mais il y a des endroits où l’interaction joue à plein et d’autres lieux où cela ne marche pas car la culture, les règles et les traditions ne s’y prêtent absolument pas. En revanche, partout, la curiosité domine. On imagine mal à quel point il y a chez eux un désir de savoir, d’échanger, de questionner, un intérêt pour la France.
H. Di R. : La plupart du temps, ils ne me connaissent pas ou se font une idée erronée de l’artiste que je suis. Pour ma part, à chaque fois, j’ai le sentiment d’arriver dans un monde neuf, sans a priori, où je ne suis ni connu ni méprisé. La collaboration avec les artisans s’établit sur la base d’une commande qu’ils honorent pour gagner leur vie. Ils sont rémunérés pour ce qu’ils font, c’est une relation honnête entre nous. En bons professionnels, ils tiennent à cela car ils ont un savoir-faire bien précis. Ils n’ont évidemment pas besoin de moi pour vivre et ils m’apportent ce que j’attends d’eux : leurs manières, leurs styles, leurs capacités techniques. Ce sont des gens qui ont une vraie construction personnelle et surtout une connaissance des techniques qui repose sur plusieurs générations, comme c’est le cas des maîtres laqueurs vietnamiens. En travaillant sur des techniques anciennes qui ont tendance à disparaître, ou tout au moins à être oubliées, j’ai le sentiment non pas de les sauver mais, en toute humilité, de les faire revivre, de les faire connaître ou reconnaître à nouveau. Mon projet se doit d’être abordé aussi comme la mise en valeur de pratiques précieuses, de talents exceptionnels qui ne sont pas suffisamment utilisés dans le monde d’aujourd’hui. C’est un projet de découverte esthétique, de prise en compte du monde, avec une forte teneur poétique.
H. Di R. : Ce n’est pas faux, on dit d’ailleurs que la technique induit le style. En Afrique du Sud par exemple, lorsque j’ai travaillé avec des artisans à une série de travaux de vannerie en câbles de téléphone, les « Baskets-mandalas », cela m’a obligé à modifier mes images pour qu’elles soient réalisables, qu’elles s’adaptent aux formes, rondes en l’occurrence. Finalement, ce qui me séduit, c’est le hasard et l’incidence du geste d’une autre personne que je ne contrôle pas. Parfois, il y a une volonté de ma part de ne pas maîtriser totalement la situation du point de vue technique pour laisser mon œuvre dériver vers autre chose. A mes débuts, je ne me préoccupais ni du support, ni de la technique. Désormais, la rencontre de techniques ancestrales avec le langage contemporain qui est le mien, basé sur une forte culture urbaine, favorise aisément le renouvellement de ma peinture et de ma sculpture.

Détail : Vannerie en câbles de téléphone, au musée de Valence (exposition : Hervé Di Rosa. Ses sources, ses démons.) © Q+E
H. Di R. : J’ai longtemps pensé les choses assez cloisonnées avant de m’apercevoir que ce n’était pas si vrai. Il m’arrive d’employer dans certaines œuvres des techniques auxquelles j’ai été initié dans le passé, comme la technique pyramidale de la tempera qui a resurgi dans des séries assez récentes à l’univers totalement décalé. Je l’ai constaté avec les « Di Rosa Classic » lorsque j’ai redonné vie aux personnages que je ne peignais plus depuis des années mais qui vivaient en moi, m’en servant intellectuellement pour mille choses. En examinant d’un peu près, on peut constater que plusieurs séries dans les années 2000 bénéficient de toutes les pratiques de peinture différentes que j’ai pu expérimenter. Je peux y puiser à loisir et elles me servent toujours aujourd’hui. Tu le sais, mon souhait serait qu’un tableau résume un jour ma démarche, concentre plusieurs techniques différentes pour rappeler ma vision du monde et mon nomadisme.
L D.- H. Di R. : Oui, j’y suis depuis relativement longtemps, tu as raison de le souligner, même si j’éprouve toujours ce besoin de bouger, de me régénérer en permanence. Mes étapes s’allongent, peut-être parce que j’ai beaucoup voyagé aussi. A Lisbonne, j’ai entrepris un travail d’étude de la céramique dont je n’ai pas encore épuisé les ressources.
H. Di R. : Oui, mais pas d’une façon aussi poussée, qui plus est dans une ville dont les murs des maisons sont recouverts d’azulejos, dans un lieu prédestiné, historique, où j’ai emménagé un studio provisoire, la manufacture de la Viúva Lamego fondée en 1849, où je me suis approprié une tradition ancestrale qui combine science des couleurs et secrets de cuisson. Ce travail a donné naissance à une série de céramiques uniques, peintes à la main sur la plâtrerie et les volumes traditionnels que j’ai détournés à ma manière et que le public peut d’ailleurs découvrir dans le parcours de l’exposition au musée de Valence.