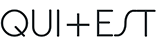Comment se construit une programmation d’artistes contemporains au sein d’un monument historique ? Le lieu et son histoire, ont-ils une influence sur les choix ? Comment les artistes s’adaptent ou non aux contraintes ? Hélène Lallier, ancienne directrice du Centre d’art contemporain (fermé depuis 2016) (*) situé dans le château médiéval sur les hauteurs de Montélimar, fait part de ses réflexions et de son expérience pendant six années dans ce lieu patrimonial, dynamique au sein du réseau drômois et très envié par les autres départements. Elle est interviewée par Emma Margiotta qui prolonge ses recherches sur l’art contemporain dans les châteaux de la Drôme et de l’Ardèche (*) .
Auteure :
Emma Margiotta
Entretien avec Hélène Lallier en octobre 2021
HL – À l’époque, j’arrivais d’un petit centre d’art contemporain situé en pleine montagne, à 800 mètres d’altitude, loin des grandes villes, entre Lyon et Genève […]. Quand j’ai été lauréate dans la Drôme, c’était pour moi une étape au-dessus. J’ai vu dans ce château un formidable outil porté par le Département de la Drôme, symbolique d’une politique culturelle et artistique forte et puis, c’était un lieu touristique (ill. 1). Je me suis dit que j’allais pouvoir jouer sur l’attractivité territoriale et montrer des artistes […] au sein d’un monument historique assez exceptionnel. C’était un enjeu, une complexité, et donc un défi à relever. A noter que ce lieu était déjà positionné puisqu’il y avait eu, avant moi, plusieurs années de programmation avec des commissaires d’exposition extérieurs très référents.
Immédiatement, la dominante de l’in situ m’intéressait car il s’agissait de proposer des artistes qui devaient aller à la rencontre de ce lieu. Le regard que je portais était de me dire que, pour les artistes ce serait un beau défi et, pour moi, un challenge de développer les publics tout en montrant ces créateurs dans ce contexte inédit.

1 – Château des Adhémar, Montélimar © B. Adilon



2 – Exposition de Marie Hendriks « Adhemarie Show », 2012 (Chapelle Saint-Pierre) © B. Adilon 3 – Exposition de Muriel Rodolosse « On the ruins of the pizzeria », 2014 (Loggia) © B. Adilon

4 – Exposition de Guillaume Bardet « L’usage des jours. 365 objets en céramique », 2012 (Salle haute) © B. Adilon
HL – La chance de cet écrin, c’est qu’il est caché. Corollairement, il est difficile d’accès physiquement. La signalétique pour y accéder est problématique […] et puis, la communication était compliquée. Plus largement, au-delà de ce côté territorialisé, je trouvais – je m’en suis rendue compte assez rapidement du fait des échanges et du positionnement – que c’était la dernière roue du carrosse dans les trois châteaux : le moins séduisant de prime abord car plus sobre que les châteaux de Grignan et de Suze-la-Rousse, avec un art actuel dit parfois « élitiste ». Bref, un lieu moins populaire et donc moins attractif. Ma mission était aussi de mieux accompagner sa visibilité. Quand je suis arrivée, j’ai conscientisé immédiatement qu’il faudrait initier et développer des actions de sensibilisation et un gros travail de relationnel ; au-delà bien sûr d’une programmation exigeante et liée à son territoire car dans une proximité environnante avec un public non acquis. Les dix ans d’art contemporain passés avaient drainé un public très ciblé (lyonnais, parisien l’été) ; les montiliens connaissaient peu leur château : le challenge se situait aussi dans le ré-ancrage de son projet culturel et artistique. La problématique était donc complexe : positionner le lieu dans son territoire tout en respectant un cahier des charges artistique établi sur une programmation de qualité, diversifiée, à partir de pratiques de tous horizons.
Faire une programmation, c’est confectionner une recette à l’année, voire sur plusieurs années. Ainsi, à « La Belle Échappée » (ill. 5) en 2014-15, exposition collective autour de l’enfermement et l’aspect carcéral de cette ancienne prison, a succédé début 2015 le « Collectif Les Climats » – établi en Drôme -. Il s’agissait d’accompagner cinq jeunes photographes autour de la question du paysage. Puis j’ai élu Marcos Avila Forero (ill. 6) un jeune plasticien d’origine franco-colombienne fasciné par les déplacements des peuples, des idées et des cultures, et dans l’expérimentation des territoires. L’été, ce fut au tour d’Andrea Mastrovito, un dessinateur d’origine italienne qui a questionné l’histoire et la religion, le savoir et les arts créant des œuvres inédites pour chacun des trois châteaux. Et enfin, l’automne a révélé les installations spatiales et sonores de Cécile Le Talec, artiste déjà reconnue, dans un projet générateur d’un circuit numérique Drôme-Ardèche qui liait diverses structures ; elle a d’ailleurs fait l’objet d’une résidence de production à Moly-Sabata (Isère), un partenaire. Toutes les dimensions précitées du cahier des charges prenaient corps et sens dans ces choix.

5 – Exposition « La Belle Échappée », 2014-15 © B. Adilon

6 – Exposition de Marcos Avila Forero, 2015 © B. Adilon
HL – Oui puisque la problématique est différente : quand on part à la rencontre d’un artiste et pas d’un collectif, il s’agit d’entrer dans un univers, une globalité, d’aller vers un panel de pièces de toutes sortes. Ainsi, je faisais un choix avec lui/elle dans un corpus d’œuvres existantes et nous envisagions ensemble la production ; car au château des Adhémar, j’avais la chance de gérer un budget de production pour chaque exposition. Il y a également le rapport à l’espace qui importe : il faut « prendre d’assaut » ce château, vaste et doté d’espaces variés (loggia, chapelle, grandes salles, etc.). Nous ne sommes pas du tout sur les mêmes problématiques pour mettre de la vie et faire sens avec l’espace : avec un collectif, le puzzle n’est pas pris dans le même sens. Il fallait réfléchir les uns avec les autres et trouver la cohabitation entre eux et dans l’espace. Avec un seul artiste, cela revenait à focaliser sur « comment penser l’espace au travers d’un corpus d’œuvres du même créateur ? ».
Puis, ce ne sont pas les mêmes rencontres : avec un collectif, les œuvres vont raconter une histoire entre elles qu’il y ait thématique ou pas ; on doit révéler le sens en partant d’une variété. En 2016, avec « L’A(i)R d’en rire », c’était le cas. Avec une exposition monographique (ill. 7), le focus est sur la valorisation d’une démarche, d’une unité qu’on déploie, qu’on diffuse. Aux Adhémar, il y en a eu de nombreuses que ce soit avec Marie Hendriks, Victoria Klotz, Su-Mei Tse, Bill Culbert ou encore Emmanuel Régent. Cela permettait de mettre la lumière sur la richesse d’une œuvre, d’une sensibilité.
Enfin, choisir des artistes, c’est se tenir au courant de tout ce qui se fait, sachant que notre propre sensibilité nous amène sur certains créneaux plus que d’autres, en lien évidemment avec le lieu où l’on programme. Pour moi, c’était toujours raccroché à la notion d’in situ qui est inhérente au lieu . Je ne pouvais pas prendre cet édifice comme une galerie : pour moi, au château des Adhémar, on ne pouvait pas tout montrer vu le cadre. Les démarches devaient être pensées en fonction du lieu.

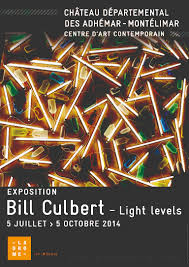

7 – Expositions monographiques : Mat Collishaw, « La vie de château », 2013 / Bill Culbert, « Light levels », 2014 / Cécile Le Talec, 2015-16
HL – Dans la mesure où nous avions un budget de production, il y avait beaucoup d’œuvres inédites faites pour le lieu, pensées en fonction de celui-ci. Dans chaque exposition, il y avait le choix d’une œuvre à produire – à minima – ou de plusieurs. Le tout était calibré en fonction du budget. Finalement, il y avait donc toujours de l’inédit : ce qui était une chance car le public savait, en venant au château des Adhémar, qu’il allait découvrir quelque chose de spécial, de réfléchi avec/pour le lieu.
HL –Pas forcément. C’est possible si on ne veut pas prendre de risque car on sait que l’artiste saura s’en sortir s’il a déjà exposé et/ou conçu des œuvres pour des expositions dans des édifices historiques. Ce n’est pas un gage de qualité en soi. On peut avoir l’audace de solliciter un très bon artiste dont on sait qu’il intègrera la complexité du lieu, comme mise à l’épreuve, et révéler autre chose dans son travail dans ce contexte singulier. C’est une prise de risques mais en même temps, quand on est programmateur, c’est induit. Sinon, on tombe dans le consensus. Pour moi, l’objectif était de faire découvrir une pratique, un artiste, une œuvre dans un lieu atypique, et à un public.
HL – Quand je choisissais un artiste, il venait visiter le site pour se faire une idée, éprouver la spatialité. Puis, il réalisait une note de projet, une proposition d’exposition et/ou d’œuvres pour ce lieu. Nous en discutions afin de trouver le point de rencontre entre ce qu’il avait envie de proposer et ce que j’attendais de manière informelle et/ou intuitive dans cette future exposition. Pour porter un projet, il fallait que nous soyons en accord ou alors c’était une « carte blanche » et je laissais l’artiste choisir les œuvres et la scénographie. Mais, présentement, c’était vraiment un travail de réflexion, d’échanges et de collaboration, ainsi que de coproduction. Les pièces, on les choisissait ensemble. Quand un artiste me proposait ce qu’il souhaitait faire, je lui demandais de m’expliquer le sens, le pourquoi. Sachant que, pour autant, entre ce que vous propose un artiste dans une note de projet et ce qu’il vous dit et ce qui arrive, il peut y avoir un grand écart.
HL – Quand c’était une exposition collective (ill. 8), j’avais une thématique […]. Je choisissais les artistes et après chacun faisait une proposition. Je choisissais aussi des pièces en fonction des espaces et des pièces les unes avec les autres. […] La première chose, c’était l’exigence artistique puis, il fallait jouer sur les mises en espaces, les complémentarités et la diversité. Avec du recul, je me suis rendu compte que, parfois, il pouvait y avoir un ou deux artistes moteurs dans le système et autour de leurs démarches se greffaient les autres, en fonction des diverses maturités des pratiques, de la reconnaissance plus ou moins affirmée. Il y avait des œuvres qui étaient déjà confirmées dont on savait qu’elles feraient sens dans l’environnement qui allait être le leur ; ainsi nous allions véritablement découvrir la démarche et l’intention de l’artiste. Pour d’autres travaux d’artistes, ils allaient se révéler dans la proximité, l’écho des autres œuvres. Il fallait parvenir à ce que chacun trouve sa place au travers des autres ou à côté des autres.
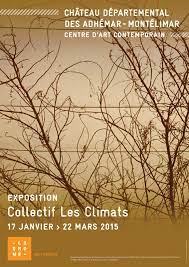


8 – Expositions collectives: « Collectif Les Climats », 2015 / « L’a(i)r d’en rire », 2016 / « La Belle Échappée », 2014-15
HL – C’était en fonction de l’artiste, il n’y avait pas de choses systématiques, ça dépendait beaucoup de la situation de l’artiste dans son parcours. J’avais plutôt tendance à donner une « carte blanche » à un artiste que je savais déjà rôdé. Il ne s’agissait pas d’une commande, mais le fruit de nombreux échanges avec l’artiste autour de son projet. Après, les échanges étaient aussi au niveau de la construction des pièces avec moi, l’artiste et les deux régisseurs techniques des Adhémar. Force est de constater que si certains artistes produisaient ailleurs globalement, au vu de difficultés d’accès au château, d’une problématique de transport des œuvres, et du fait d’avoir les ressources sur place, la production était réalisée sur le territoire. Les contraintes techniques venaient en effet jouer sur les protocoles de production.
HL – Je n’étais pas dans les salles comme les médiateurs du Centre d’art mais j’avais leurs retours. Ainsi, dans la mesure où, d’une part, était affiché « Centre d’art contemporain » au sein du château des Adhémar, dans ce monument historique et, d’autre part, qu’il y avait une antériorité de publics « art contemporain », les visiteurs venaient en pleine conscience. Après, des réactions « j’aime » ou « je n’aime pas » existaient. Pour autant, le public savait qu’il allait, au vu d’une programmation établie sur cinq expositions par an, découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau et d’inédit (production). Evidemment, pour les néophytes qui n’avaient pas compris qu’il y avait un centre d’art contemporain, c’était à double tranchant.
Il apparaît que, dans la mesure où les expositions étaient pensées pour faire sens, les médiateurs allaient vers une approche très didactique et pédagogique du type « nous sommes dans un monument historique qui, depuis plusieurs années, accueille un centre d’art contemporain ; vous allez donc découvrir une exposition d’art actuel qui joue et interpelle le lieu ». Dès lors, on voit ça comme une plus-value. En effet, vous avez un évènementiel, un projet inédit, qui s’épanouit à l’intérieur de ce monument historique. Après, il existe toujours des réfractaires à l’art actuel qui l’écrivent à la sortie dans le livre d’or. Au château, on pouvait juste visiter le site (chemin de ronde, extérieurs). Nous avions pris le parti de travailler les options pour ne pas prendre en otage les gens. L’ADN de ce site était dans cette union qui était une force entre patrimoine historique et art contemporain ; la commande politique était ainsi. C’était à nous ensuite de produire un plan et de décliner des actions de sensibilisation pour accompagner au mieux les gens dans cette découverte.
HL – J’ai souvenir d’avoir eu cette réflexion une ou deux fois sur la loggia dont les vitres avaient été partiellement occultées par des créations (Andrea Mastrovito avec ses règles transparentes en 2015 par exemple) ; j’avais développé le protocole et le parti pris de l’artiste en expliquant qu’à chaque exposition, l’appropriation du lieu est différente. En tant que Centre d’art contemporain, la commande était de faire des expositions.
En fait, j’aurais tendance à dire que je ne me posais pas vraiment la question parce que les artistes jouaient beaucoup avec. Quand nous faisions le tour avec un artiste, on lui disait ce qu’il ne fallait pas toucher et on leur demandait si ça pouvait faire partie de leur œuvre ou non. S’il voulait que ce soit occulté, nous indiquions la problématique pour nous et nous les laissions réfléchir. On savait très bien que sur les cinq expositions par an, ça varierait. […] À partir du moment où il y avait un choix artistique, avec l’artiste on pensait l’espace de manière globale donc parfois les éléments dont vous parlez étaient visibles, parfois ils ne l’étaient pas. Il est arrivé que des artistes aient vraiment travaillé la question des murs et de l’architecture du lieu. Pour d’autres, il s’agissait de leurs démarches au sein de cette architecture. A titre d’exemples, en 2014, que ce soit Su-Mei Tse (ill. 9) ou Muriel Rodolosse, chacune avec leur esthétique jouait avec la spatialité et les éléments d’architecture, l’une avec les fresques murales du rez-de-chaussée, l’autre avec l’aspect confiné mais ouvert sur la ville de la loggia. Quant à Bill Culbert, avec notamment « Level », il mettait en perspective l’architecture avec la ville via des bombonnes semi-remplies d’eau devenues réceptacles de « morceaux » du paysage environnant.

9 – Exposition de Su-Mei Tse, 2014 © JP Bos
HL – Ma démarche c’était vraiment de travailler avec le lieu, de le révéler. À ce titre, j’ai beaucoup regardé ce qui avait été fait avant mon arrivée. J’ai noté des expositions extrêmement déconnectées, pour moi, sous certains angles, de la question du sens et de l’in situ […]. Je partais aussi du principe qu’il fallait y aller par étapes pour sensibiliser les gens. […] Dans un lieu patrimonial, on doit faire attention au public parce qu’on n’est pas dans une galerie. […] De plus, dans l’année, sur l’ensemble des expositions, il fallait être dans la diversité, c’est-à-dire initier une exposition monographique, une exposition collective, présenter une démarche reconnue et aussi de l’expérimentation. Autrement dit, essayer de panacher entre diverses options de monstration. Ainsi les fidèles qui venaient à chaque exposition ne devaient pas avoir l’impression d’être dans quelque chose de monolithique mais avoir envie de revenir, de découvrir à chaque fois. C’est peut-être le plus grand challenge en tant que programmateur parce qu’in fine un public se jauge à l’année. Et puis, les artistes nous aident à réfléchir, à avancer : on se repositionne en permanence quand on programme entre montrer une démarche artistique et parvenir à la rendre intelligible de tous et pour tous.
HL – C’était un moteur, un chef de file, on le portait comme tel car je travaillais pour la Régie des Châteaux de la Drôme (*) mais j’étais aussi chargée des arts visuels pour le Département de la Drôme. A ce titre, au château des Adhémar, avaient été initiées des réunions entre acteurs visuels du territoire Drôme et Ardèche, à l’exemple d’une formation en médiation. Nous étions un des plus « gros » sinon le plus « gros » centre d’art contemporain de la Drôme, et porté par le Département. Il y avait donc vraiment une mission territoriale qu’une convention bi-départementale venait enrichir. Nb : au-delà de mon rôle aux Adhémar, c’était déjà un centre d’art contemporain reconnu et il avait toute sa légitimité à fédérer les autres.
Avec le public Montilien, nous avons précisé et renforcé la communication parce que la plupart des gens pensaient qu’un vernissage était privé : d’où la nécessité première de trouver les bons visuels pour « accrocher » et de noter « entrée libre » par exemple pour que les gens viennent (ill. 10). Le relationnel, le travail d’échanges avec les partenaires étaient majeurs pour sensibiliser et attirer les publics ; à ce titre, nous avons beaucoup œuvré pour toucher des publics diversifiés, éloignés de la culture et de l’art tels les centres médico-sociaux dans lesquels des artistes, suivant un projet défini préalablement, intervenaient. Le milieu scolaire était un partenaire important : et pas uniquement celui de Montélimar mais les élèves Drôme/Ardèche. Ainsi, pour toucher un large public, il y avait la communication mais aussi les actions sur le territoire qui permettaient de faire découvrir le château, la démarche d’un artiste et de pratiquer. Pour souvenir, nous accueillions les publics d’un institut médico-éducatif et d’un centre médico-social, un panel d’établissements (écoles primaires, collèges, lycées) jusqu’au sud de la Drôme (Pierrelatte). Parfois nous avions la surprise d’enfants accueillis dans ce cadre et qui revenaient au vernissage avec leurs parents par effet d’attraction. Des projets d’actions artistiques étaient développés sur le site ; des visites régulières avec des ateliers de pratique sur place pendant une demi-journée, aussi.

10 – Vernissage de l’exposition d’Emmanuel Régent, « Sortir de son lit en parlant d’une rivière », 2012 © JP Bos
HL – On en discutait beaucoup avec mes collègues pour jouer sur les complémentarités. Concernant la politique des publics, nous réfléchissions aux formules en fonction de chaque château. Pour autant, il y a un moment où s’est posée la question d’un artiste qui interviendrait sur trois châteaux (comme cela avait par exemple été initié avec Daniel Buren antérieurement). Echangeant avec Chrystèle Burgard, co-directrice des châteaux, j’ai proposé un artiste qui pourrait relever ce défi : Andrea Mastrovito (*). Je le connaissais bien pour avoir déjà travaillé avec lui, consciente de sa pratique riche et diversifiée établie autour du dessin, de l’installation et la vidéo, ainsi que de son écoute ; tout ceci jouait en sa faveur. Ainsi, je lui ai proposé, précisant l’identité propre à chaque château dans une cohérence globale à l’échelle du territoire et d’une gouvernance commune. Nous avons visité les trois châteaux et Andrea Mastrovito a fait une proposition pour chacun, dans un lien de déambulation entre les trois appuyant l’effet d’entrainement de l’un à l’autre ; ce qui a permis de drainer un public et conforter une irrigation du territoire.
Il aura fallu trois années avant que je ne propose ce projet à l’échelle des trois châteaux car, à mon arrivée, une des facettes de la commande politique était d’ancrer, de recentrer sur l’identité du château des Adhémar pour aller vers le public environnant, notamment Montilien. D’où le parti pris d’ailleurs de la codirection des Châteaux de positionner un commissaire d’exposition sur site afin que ce Centre d’art soit incarné. J’ai donc démarré ma mission en ce sens, affichant une ligne artistique, une communication et en développant et diversifiant les publics. Puis, j’ai programmé dès 2014 ce projet d’Andrea Mastrovito révélé en 2015 (ill. 11). La logistique, le mode opératoire ont été plus ambitieux et plus lourds car des productions ont été initiées dans chacun des châteaux.
11 – Expositions d’Andrea Mastrovito, 2015 : Montélimar : Procession, crayon sur papier calque / Suze-la-Rousse : Dîner, nous sommes tous Américains, crayon sur table, couvert et assiette en bois, livre et carte / Grignan : The unnamed feeling (l’indicible sentiment), plâtre sculpté dans l’oratoire © A. Mastrovito

HL – Dans un white cube aussi il devrait y avoir de la médiation parce qu’on se retrouve tout seul dans une galerie où souvent certains osent à peine rentrer car avec des codes d’un espace marchand […]. Je me rappelle qu’au Centre d’art contemporain du château des Adhémar, l’offre pédagogique était très forte : avant mon arrivée, il y avait déjà un panel d’outils et j’ai œuvré à ce qu’on en mette d’autres en place et qu’on touche des publics plus diversifiés. Nous réfléchissions à des formules liant art contemporain et patrimoine. À mon arrivée, nous avions fusionné les brochures « patrimoine » et « art contemporain » pour affirmer l’identité du lieu. C’était un grand défi d’être cohérent et de défendre une image totale. Pour moi, c’était un axe stratégique à développer, car si ce n’est pas lisible, les gens s’y perdent et c’est source de mécontentements.
Nous avions un programme riche de visites guidées, de visites-ateliers car la médiation passe, au-delà des outils, par l’humain, la parole ; ça désamorce tout. Après, pour moi, la rencontre avec une œuvre est une expérience personnelle, qui opère ou pas. Certains ne feront jamais cette rencontre.
HL - Je ne pense pas. À partir du moment où il y a une volonté d’ouvrir un lieu historique à une démarche contemporaine, on ouvre un possible qu’il faut accompagner et où il faut mettre les moyens. On ne peut pas se rater justement parce qu’il y a une identité dans laquelle on va projeter quelque chose donc nous avons peut-être, en revanche, moins le droit à l’erreur.
Tout dépend de la manière dont on aborde chaque lieu mais ils ont tous quelque chose à dire. L’art contemporain peut être un formidable révélateur dans un lieu historique. Moi je suis toujours très attirée par cela, me questionnant sur : « comment ce lieu va réussir à s’exprimer avec l’art et réciproquement, comment l’art va trouver sa place dans un lieu aussi chargé, aussi contraint et aussi marqué historiquement ? ». Je trouve que c’est une formidable rencontre donc j’aurais tendance à dire que tous les lieux ont quelque chose à dire et que beaucoup de démarches artistiques peuvent s’y exprimer.
C’est sûr que ce sont des contraintes fortes car ces lieux ne sont pas forcément faits pour accueillir des démarches artistiques mais le challenge est là pour un artiste : « comment ma pratique va s’exprimer dans un lieu qui a ces problématiques et contraintes ? ».
HL - On ne peut pas faire n’importe quoi dans ces lieux car ce qui est fondamental dans l’in situ, c’est le rapport à l’espace. Au Centre d’art contemporain du château des Adhémar, le cahier des charges intégrait le rapport à l’histoire et au territoire. Les projets devaient tenir compte du lieu dans lequel ils se développeraient. Ensuite, c’est subtil de trouver la bonne démarche, la bonne œuvre. Sachant que les artistes questionnent le monde, il s’agit donc d’élire ceux qui souhaitent s’intéresser à ce type de lieu ; aux Adhémar, par exemple, en 2013, Mat Collishaw (ill. 12) a proposé de grandes installations vidéo (4 x 5 m) et des séries de photographies qui rendaient hommage aux grands maîtres sous un angle contemporain (Bacon, Dürer, de La Tour), abordant la religion, la politique, l’écologie. Emmanuel Régent, lui, dans un projet ancré dans trois lieux d’exposition (deux en Drôme, un à Montpellier), était dans une approche plus formelle, plus sculpturale ; Victoria Klotz (ill. 13), elle, a travaillé à révéler le lien nature/culture en proposant des installations sur l’animalité dans une dimension poétique du lieu. Au final, toutes leurs démarches faisaient sens chacune à un niveau différent ; elles ont donc enrichi la découverte du lieu.
Aussi, j’aurais tendance à vous dire qu’on pourrait tout mettre dès lors que c’est pensé en fonction et avec le lieu.

12 - Exposition de Mat Collishaw « La vie de château », 2013 © B. Adilon