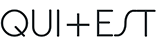Lucille Boulas © Elsa Rodrigues
« Travailler avec le vivant » est le leitmotiv de Lucille Boulas qui est passée en quelques années d’ingénieure en informatique santé à apicultrice et potière, et s’est installée à Margès dans la Drôme des Collines. Quelles sont les motivations qui l’ont amenée à cette singulière reconversion et quels liens existent-ils entre ses professions ? Quelles productions et collaborations s’inventent avec le monde du vivant ? Ce cheminement est l’objet de l’entretien mené par Emma Margiotta dans l’atelier de l’api-potière.
Auteure:
Emma Margiotta
Entretien avec Lucille Boulas
janvier 2025 à Margès
Le parcours de Lucille Boulas
Lucille Boulas – Depuis mon adolescence, je suis très attirée par les techniques artistiques comme celle de la terre. J’en récupérais dans le jardin de mes parents et j’essayais de produire des choses. Je n’étais pas accompagnée dans cette pratique. Durant mes années collèges et jusqu’au début du lycée, je pratiquais aussi énormément le dessin et la peinture. J’ai nourri l’envie d’être professeur d’arts plastiques car ces derniers étaient à cette période mes seuls modèles dans ce domaine. Cependant, mes parents m’ont dissuadé d’en faire mon métier en m’invitant à garder cet attrait là comme passion.
J’ai alors développé, pendant une quinzaine d’années, le projet d’être sage-femme. Après une première année de médecine non validée, j’ai cherché à rester dans ce secteur par le biais d’un autre diplôme. En 2016, j’ai ainsi obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique santé même si je n’ai pas d’attrait pour l’informatique. En 2018, j’ai démissionné après deux expériences dans le milieu hospitalier, une dans le public et une dans le privé. Je me suis rendu compte du fossé qu’il y avait entre mon propre désir d’accompagnement des personnes et du soin humain, et la réalité, celle du rendement, de la tarification à l’acte ou encore de la suppression des postes. Je me sentais mal à l’aise vis à vis de cet écart entre mes valeurs et ce que je découvrais. J’ai eu des difficultés à me rendre compte de ça (*).
En parallèle, je me suis formée à l’apiculture. Concernant les abeilles, j’arrive moins à déterminer la provenance de cet intérêt si ce n’est le fait de travailler avec le vivant. J’ai eu l’opportunité de faire une formation pour adultes au CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) de Die pour des ruchers de moins de trente ruches. À l’issue de cette période de double formation, j’ai lancé mon activité. »
Terre & Miel : « Se reconnecter au vivant et à la nature »
J’ai créé mon statut Terre & Miel le 1er janvier 2020. Au départ, j’ai été accueilli par une potière – qui a pris sa retraite depuis – à Claveyson. Depuis un an, je recherchais un lieu où m’installer afin de poser mon tour et de faire cuire des pièces. Elle m’a ouvert les portes de son atelier où elle ne dispensait plus de cours. J’ai commencé à faire mes premières séries dans la perspective de participer à des marchés d’été. Ces derniers ont été annulés en raison de la crise sanitaire, puis reprogrammés et j’ai pu y participer. Dès le début, je me suis sentie accueillie par les potiers et les potières et assez reconnue dans cette discipline que je n’exerçais que depuis quelques mois de manière professionnelle. J’étais étonnée que personne ne me posait la question de ma légitimité à savoir : « qu’est-ce que j’avais fait ? », « d’où je venais ? » ou encore « quel était mon parcours ? ». J’ai été rassurée.
Il y a moins de deux ans, pendant l’hiver où ma fille naissait, j’ai malheureusement perdu mes ruches. C’était très déstabilisant, un cycle a commencé en accueillant cet être vivant dans la famille et dans le même temps, un cycle s’est terminé. Je me suis fait la promesse de me remettre à l’apiculture uniquement quand je pourrais installer mes ruches auprès de moi. Actuellement, je ne dispose pas de terrain personnel. Mes ruches se trouvaient à environ 1h de route de mon domicile. De plus, si je relance cette activité, je l’envisagerai par le biais d’ateliers d’initiation à l’apiculture pour emmener du public voir des ruches et faire découvrir l’univers des abeilles. Aujourd’hui, je suis du côté de la pédagogie et de la transmission plus que du côté de la récolte, du rendement et de la production de miel. Il s’agirait d’une apiculture de conservation consistant à avoir des ruches pour encourager les abeilles à se multiplier et à rester sur un territoire en particulier l’abeille noire, espèce endémique aujourd’hui en voie de disparition en France. Pour autant, je conserve cette identité, Terre & Miel, car je me sens encore proche de l’interconnexion de ces deux mondes. Je vois aussi le miel comme un symbole de douceur. J’essaie de « mettre du miel » quand j’accueille des élèves dans mon atelier et quand j’accompagne des enfants.
J’avais trouvé une forme de bien-être et de respiration dans le fait de me rendre auprès des ruches et d’être dans le vrombissement des abeilles. Je me sentais hors du monde en raison de la concentration que requiert la vie d’une ruche. Il faut du calme et de la concentration ; deux aspects qui rejoignent la pratique du tour. Enfin, ces deux pratiques sont complémentaires en raison d’aspects saisonniers. L’apiculture est une pratique majoritairement estivale car les abeilles hibernent en hiver, une saison propice à la création en poterie en étant notamment synonyme des fêtes de fin d’année.
Le jardin comme inspiration
LB – En travaillant les différentes terres, je me suis rendu compte que les productions en grès sont parfaites pour aller au jardin en résistant notamment au gel. J’utilise une terre qui vient de Bourgogne. J’ai par exemple produit deux types de nichoirs. Le premier, dit « traditionnel », permet l’accueil des oiseaux et le second, nommé « nichoir à rêves », peut servir de mangeoire en mettant des graines à l’intérieur. C’est une pièce suspendue, assez allongée, ressemblant à un nichoir, mais dont on doute qu’un oiseau puisse y nicher dedans ! De par son aspect détourné, elle peut être installée en intérieur ou au jardin. Ces productions me tiennent à cœur car elles encouragent la biodiversité et contribuent au fait que chacun puisse prendre part à cette démarche.
La transmission comme une révélation
J’ai envie de faire un parallèle avec le métier de sage-femme que je souhaitais faire. En effet, en étant auprès de mes élèves et en les accompagnant dans leurs projets, je me sens comme quelqu’un qui aide, qui contribue à l’émergence d’un objet et qui participe à la naissance de quelque chose sous leurs doigts. Je me sens utile. J’apprécie d’essayer de comprendre chez un élève la cause d’un blocage : « est-ce de nature physique ? » ; « est-ce dans son positionnement face à la matière sur le tour ? » ; « est-ce psychologique ? ». Les personnes avec qui j’engage un travail sur le long terme m’apportent, elles enrichissent ma pratique. Parfois, des choses très belles se produisent aussi lors de séances d’initiation où la personne ne vient qu’une seule fois. Enfin, je suis dans un atelier où j’ai à cœur de faire participer mes élèves dans la construction de mes cours en leur demandant ce qu’ils souhaiteraient réaliser comme pièces ou encore, quelles techniques de décors ils aimeraient découvrir.
LB – Pour l’instant, ma pratique de la poterie est très utilitaire avec des pièces dédiées aux arts de la table. J’ai comme projet pour cette année d’aller explorer d’autres chemins. Je me suis aperçue qu’en termes de créativité, ça ne me nourrit plus assez de produire des séries d’objets. Comme j’ai constamment envie d’expérimenter de nouvelles choses, c’est contraignant de travailler en série. En décembre dernier, j’ai participé au salon des créateurs du ChaluTiers, porté par l’Artisanoscope en Nord Drôme et pour la première fois, j’ai exposé deux pièces « autres », uniques, et non destinées à la vente : La Baleine qui Pleure les Océans et l’Ours. Je pense que je ne parvenais pas à les exposer car elles sont plus personnelles. Immédiatement, ça a créé des discussions très intéressantes avec les personnes qui s’arrêtaient. C’était déjà le cas avec mes pièces nommées nichoir et chante-pleure car contrairement à une tasse, à un bol ou à une assiette, on identifie moins facilement les fonctions et on s’attend moins à trouver ce type d’objets.
Je n’ai jamais eu l’opportunité d’exposer en dehors du cadre de la vente et je crois qu’il faut être prête à le faire. Il y a la légitimité en tant qu’artisane avec laquelle je suis familière en revanche, par rapport à celle en tant qu’artiste, je ne me situe pas là pour le moment. »