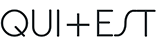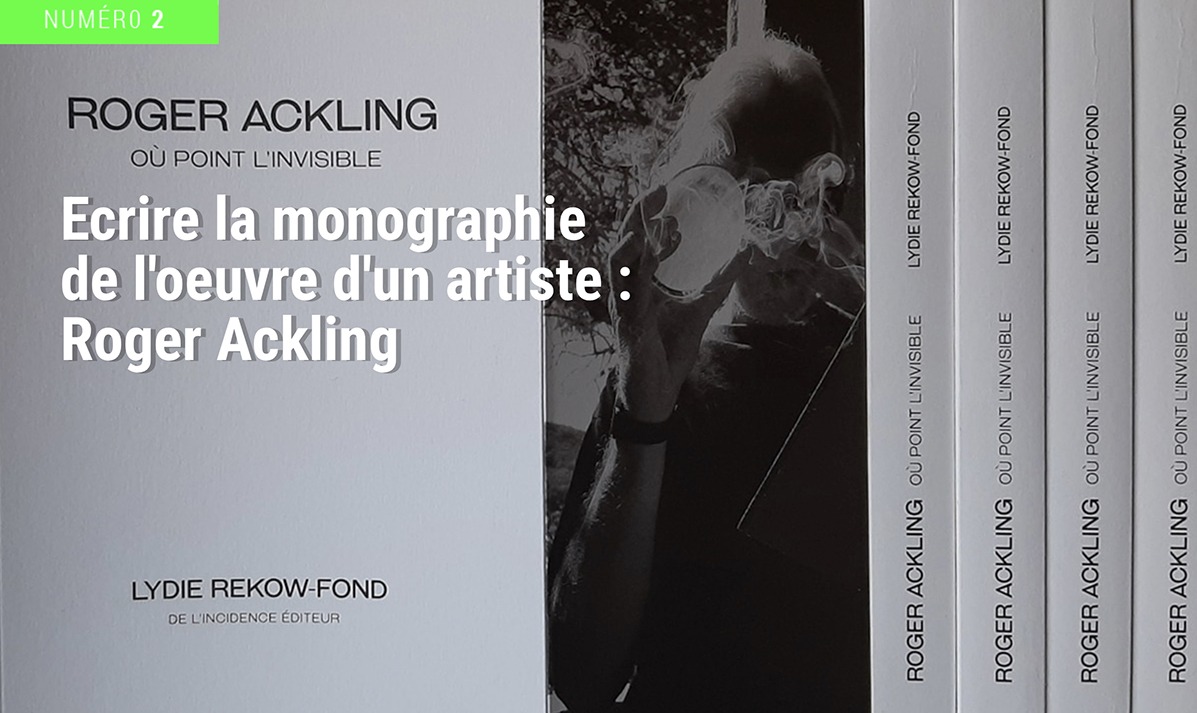
A l’occasion de la publication de l’essai monographique Roger Ackling, où point l’invisible (*), l’historienne de l’art contemporain Lydie Rekow-Fond dévoile ici sa démarche comme ʺchercheuse-interprèteʺ, du regard sensible et analytique sur les œuvres à la découverte des archives conservées dans l’atelier de l’artiste anglais, de l’expérience d’écriture à ses questionnements théoriques sur l’art.
Auteure
Lydie Rekow-Fond
Dans un texte sur le peintre Cy Twombly, Roland Barthes interroge le rôle du commentateur des œuvres. Il estime qu’elles suscitent en nous « un travail de langage, (n’est-ce pas précisément ce travail – notre travail – qui fait le prix d’une œuvre ?) (*)». En s’interrogeant de la sorte, l’écrivain octroie à ceux qui se chargent de traduire en mots leurs approches sensibles, le pouvoir de révéler l’œuvre. Le « travail de langage » s’effectue à plusieurs niveaux. Confronté à la responsabilité que lui assigne le fait de dire objectivement, le chercheur en arts doit nuancer ses analyses, mesurer l’impact des mots – dits et écrits – maîtriser l’orientation de ses examens, mais sans renoncer, jamais, à sa position intellectuelle et à l’expression de sa subjectivité, autant le dire : à son interprétation. C’est pourquoi je pense opportun de forger le terme de chercheur-interprète, pour qualifier celle ou celui qui s’adonne à la lecture d’une œuvre, à son analyse, pour en fournir une version (traduction ?).
Depuis plus de vingt ans, mes travaux de recherche en art s’inscrivent dans cette problématique méthodologique ; je m’attelle à l’analyse d’œuvres d’artistes contemporains pour lesquels j’ai été amenée à produire des expositions ou/et des publications. Comme tout chercheur, je construis une méthodologie adaptée à l’objet d’étude. J’adhère aux propos de l’historien de l’art Otto Pächt prônant « une pensée expérimentale », élaborée à partir du voir articulé au dire : « toute interprétation d’une œuvre visuelle doit commencer par le regard, mais voir est déjà penser et juger, et il n’y a donc pas de description purement factuelle (…). Si voir est la condition pour décrire, décrire aide en retour à mieux voir. » (*)
Dans ma pratique de l’analyse artistique, je me rapproche toujours, autant que possible, de « l’intention » des artistes : dans quel but telle œuvre est-elle ainsi conçue ? Travaillant dans le champ de l’art contemporain, j’essaie d’optimiser ce que la proximité avec les créateurs peut m’apporter. Leurs paroles, leurs écrits favorisent donc les études et conduisent le regard – descriptif puis analytique. Ils constituent, avec les œuvres visuelles, des éléments du corpus que j’observe toujours en premier lieu et sur lesquels travailler ensuite. C’est ainsi que j’ai mené la monographie de l’artiste britannique Roger Ackling (1947-2014).

J’ai approché sa démarche à partir de l’observation de ses œuvres, de la visite de ses expositions et de la lecture de ses écrits, non publiés, découverts après son décès dans les archives conservées de son atelier, désormais orphelin. J’ai engagé un processus de mémorisation des rencontres que nous avons eues, entre 1994 et 2014, à l’occasion d’expositions organisées ensemble, de voyages communs et d’échanges informels que seuls des amis de longues dates parviennent à tisser, sous un ciel de pleine lune ou sur le comptoir d’un bistrot… J’ai rassemblé les indices et tenté une lecture de la démarche entière de l’artiste à partir de cet ensemble d’objets, et non pas en eux. Ce petit écart, qui implique une distance, favorise une position préservée des brouillages et de l’indéfinition dans laquelle le chercheur pourrait sombrer, sans recul.
Cette monographie, publiée par De l’incidence édition, étudie le caractère temporel de la démarche singulière de Roger Ackling. J’ai choisi de repérer les temps successifs qui la structurent, tout en déterminant sa complexité : Scruter le ciel ; Saisir le temps ; Viser l’absolu. Ces trois parties marquent trois moments que l’on peut repérer dans l’élaboration des œuvres : collecte des matériaux et observation des conditions météorologiques conditionnant le temps de travail dans le paysage ; processus de création lié à un rapport au temps compté matérialisé par les points de brûlures solaires ; et philosophie de la démarche où se dégage l’ontologie fondatrice de l’œuvre au monde.
Comme leur auteur, les écrits de Roger Ackling sont sans ambition. Or, ils renseignent. Ils disent, comme les carnets de météorologie que j’ai trouvés sagement alignés sur une étagère, et par lesquels j’introduis mon étude, ils disent l’humeur, l’humour, la poésie, l’ironie, l’esprit de l’artiste d’une extrême clarté. Ils méritaient que je m’y attarde. Mon texte s’y réfère régulièrement ; la parole de l’artiste accompagne ainsi mes réflexions, mais sans l’influencer. Elle a contribué à la formation de ma position. Ses écrits jouent, dans ce sens, le rôle d’embrayeurs, car ils orientent la vision, conduisent le sens de l’interprétation. Dans l’œuvre de Ackling, ils n’interviennent pas directement, ils sont un matériau documentaire.