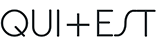SILLON est un parcours mis en place à l’automne 2021 entre 6 communes situées dans la Drôme (Saoû, Soyans, Félines-sur-Rimandoule, Truinas, Rochebaudin, Pont-de-Barret) et 20 lieux. A travers des expositions, des rencontres, des ateliers, des randonnées… il proposait d’interroger notre rapport à la créativité et de favoriser les rencontres et les partages dans un échange constant entre art, agriculture et alimentation, patrimoines, mobilités et spiritualité. Coordinateur de cet événement et commissaire d’expositions, Bastien Joussaume évoque les enjeux territoriaux et artistiques de cette manifestation particulièrement inscrite dans la question des droits culturels, et esquisse un premier bilan de cette biennale.
Auteurs :
Bastien Joussaume / Q+E
BJ – Nous habitons ce territoire et SILLON est une manifestation qui tente d’en révéler l’identité à travers ses dynamiques propres tout en le nourrissant par des invitations faites à des éléments de savoirs extérieurs. C’est en tout plus de 50 intervenants de différents secteurs qui ont été conviés à participer à cette deuxième édition. Une forme d’ambivalence s’accentue avec d’un côté les phénomènes de mondialisation liés au numérique et ce que cela peut comporter d’aplatissement des aspérités culturelles mais aussi d’enrichissement possible, et d’un autre côté, la réalité d’une relocalisation nécessaire qui implique de rentrer à nouveau en connaissance de son milieu géographique proche. En ce sens SILLON, au travers du commissariat engagé, invite aussi bien des artistes de renommée internationale comme des artistes travaillant sur le territoire, en étant avant tout vigilant à l’exigence de la pratique. De très belles propositions ont émergé cette année, que ce soit la mise en place dans une église du ‘Scribble’ de Michel François ou la magnifique proposition du céramiste Jean Ponsart sur le site d’un terrain de tennis municipal.

Jean Ponsart (Pont-de-Barret, terrain de tennis) © P. Petiot
BJ – En effet, il nous semble important que les écoles d’art, figures incontournables du milieu de l’art, trouvent une place cohérente dans SILLON. Un projet de médiation s’est engagé avec l’ESAD de Saint-Etienne impliquant 20 étudiants sur l’écriture de texte présent dans l’édition du livret 2021 et la médiation sur les lieux d’expositions. Quels retours positifs des visiteurs sur la qualité de leur engagement ! Et ce malgré un travail difficile de présence corporelle 8h d’affilée dans des lieux parfois un peu âpres. Bravo et encore un grand merci à tous ces jeunes !
L’objet d’un deuxième partenariat a été l’exposition de 11 étudiants tout juste diplômés dans le porte-cloche de Rochebaudin.
Superbe implication également de l’ESAD de Valence sur l’impression des programmes et affiches en risographie (*) ainsi que la mise en place d’un voyage d’études des étudiants intégrant l’école et qui a permis, au dire des professeurs, une riche expérience participant de la cohésion de cette promotion.
C’était pour nous également si vivifiant de voir toute cette jeune énergie s’investir ainsi dans la manifestation.
BJ – Laurence Cuny, présidente de l’association LAMIS qui porte SILLON, est engagée à l’international sur les questions de droits culturels et travaille notamment avec l’UNESCO ou encore l’Observatoire de Fribourg en tant que juriste et chercheure. SILLON s’appuie sur ce cadre international et notamment la définition de la culture comme recouvrant « les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité́ et les significations qu’il donne à son existence et à son développement ».
Cela me permet dans la programmation de SILLON d’aborder les droits culturels comme un bel outil pour réussir à redéfinir et replacer la culture dans son sens le plus généreux au cœur d’une société. C’est avant tout partir du principe que chaque personne, chaque entité vivante, voire même chaque objet, par les caractéristiques et l’histoire qu’il ou elle comporte, est en mesure d’enrichir l’autre et de participer ainsi à la constitution d’un ensemble culturel. C’est un contrat de reconnaissance mutuelle, si important à l’heure actuelle, qui nous fait tout à coup sortir de l’unique culture des arts pour aller établir dans une formidable horizontalité ou circularité cet ensemble culturel complet et diversifié où chacun est reconnu dans sa singularité. C’est ce que nous tentons d’incarner dans SILLON en positionnant aux côtés de la proposition artistique évoquée plus haut un ensemble de pratiques, de savoirs et savoir-faire participant d’un monde multiple et issus, de la même manière que l’art, d’une forme de recherche et de quête de sens.
Il était enthousiasmant de voir des agriculteurs ouvrir les portes de leurs fermes et partager avec leurs mots les enjeux de leurs pratiques. La rencontre chez et avec Valery Martineau, maraîcher en permaculture, Hervé Coves, frère franciscain agronome et Jonas Delhaye artiste invité, a donné lieu à des échanges incroyables où nous percevions bien l’intérêt du décloisonnement et de la rencontre de ces cultures diverses. Cette transversalité est au cœur de SILLON et l’ensemble du programme retranscrit bien ces volontés d’ouvertures, de rencontres et de communs.
L’important semble être une sorte de mise en créativité générale. Un agriculteur réinitialisant sa pratique est tout aussi créatif qu’un artiste et se situe dans une forme de recherche. Si l’on continue encore aujourd’hui à considérer notamment au travers de l’action culturelle, l’importance du partage et de la transmission des médiums artistiques, qu’en est-il des gestes agricoles reconnus culturellement et sortis de leurs automatismes ? Quels potentiels émancipateurs liés à la grelinette et au râteau ? Cela me renvoie à une citation de Joseph Beuys qui se révèle d’une toujours aussi grande modernité : « Au titre [du] concept d’art anthropologique, chaque homme est un artiste. En chaque homme existe une faculté créatrice virtuelle. Cela ne veut pas dire que chaque homme est un peintre ou un sculpteur, mais qu’il y a de la créativité latente dans tous les domaines du travail humain. La question, c’est la capacité de chacun sur son lieu de travail, ce qui compte c’est la capacité d’une infirmière ou d’un agriculteur à devenir une puissance créative, et à la reconnaître comme une partie d’un devoir artistique à accomplir. […] J’étais récemment à Madrid et j’ai vu à quel point les hommes qui travaillent au ramassage des ordures sont de grands génies. On le voit à la manière dont ils font leur travail et au visage qu’ils ont en le faisant. On voit qu’ils sont les représentants d’une humanité future. Et j’ai vu chez ces éboueurs quelque chose que je ne retrouve pas chez les artistes merdiques (…)(*)

Thierry Boutonnier, « Récolte de rosée » à la ferme des blés barbus.

Rencontres autour du silence dans les pratiques religieuses et spirituelles à l’église St Marcel de Soyans.
BJ – On peut observer commencer à poindre certains dangers d’une mauvaise compréhension des droits culturels et de leurs tentatives d’application. Ils sont par exemple à mon sens en mesure de contenir des formes de revanche populaire sur les élitismes dans cette compréhension faussée que tout se vaut. Les amalgames avec des dynamiques d’éducation populaires et l’erreur de certaines politiques d’engager un premier processus par le biais des pratiques amateurs ne crée que crispation chez les professionnels et elle est bien légitime. Il n’en serait peut-être pas de même si nous commencions plutôt par établir des relations d’horizontalisations avec le sport, le tourisme ou l’éducation. On conçoit sans difficulté que la pratique du sport puisse être source d’’attachements, de sociabilité et émancipatrice et qu’en même temps que des personnes s’engagent professionnellement pour atteindre l’excellence dans leur discipline sportive. Il n’y a là aucune incompatibilité mais placer ces pratiques sur les mêmes enjeux ou considérer par exemple être en mesure de mener des politiques culturelles par simple goût personnel et rendre accessible la culture des arts en nivelant par le bas, c’est toucher là à des dynamiques populistes. Certaines pratiques participent d’une évolution sociétale, d’autre pas, c’est un fait et tout est à reconnaitre à sa juste valeur.
Par ailleurs il n’est finalement peut-être pas plus question dans l’art de plaisir et de divertissement qu’il ne l’est dans les sciences dures. La recherche artistique participe autant à l’évolution du monde que n’importe quelle recherche scientifique qui, elle, est par ailleurs financée sans attente de résultats précis. Il doit en aller de même de ce soutien pour les artistes. On ne peut plus continuer à jouer le jeu de milieux refermés sur eux-mêmes et c’est bien aux institutions qu’incombent ces rôles de passeur et de transmetteur. On demande à ce que la recherche effectuée par les artistes puisse être retranscrite de manière claire et altruiste afin de servir le plus grand nombre et en ce sens aux collectivités d’être en mesure de garantir ces espaces de recherche tout en maintenant des vigilances quant à l’exigence des pratiques. Il faudrait pouvoir s’inspirer de cette expression de Jean Vilar : » l’élitisme pour tous ! » Outre la biennale SILLON s’engage à travers un groupe de réflexion active, sur une structuration territoriale des reconnaissances culturelles.
BJ – On entend beaucoup de positions militantes refusant de faire avec les financements publics afin de préserver une soi-disant forme d’autonomie, de liberté, etc. Au sein de SILLON, nous avons une position inverse et nous voulons travailler et avancer avec les financeurs publics : entrer en relation avec eux et entretenir un climat de confiance et de réciprocité est parfois un moyen de comprendre plus précisément des mécanismes et faire entendre qu’un autre fonctionnement est peut-être envisageable, c’est aussi une manière de faire évoluer les pratiques. C’est enrichissant. Nous portons entre autres une critique constructive sur l’action culturelle ou l’on constate qu’elle est toujours menée de la même manière avec des publics souvent identiques comme les scolaires, les EPHAD, etc. Pourquoi ne travaillerait-on pas avec une couche sociale générale plus large et représentative pouvant devenir agissante sans faire de focus sur des publics captifs et ainsi sortir aussi de cette idée du social pour le social un peu à l’ancienne dans lequel on s’adresse de manière condescendante et descendante aux publics et ou la culture des arts semble être là pour venir instruire le « bas peuple ». C’est par la reconnaissance des cultures de chacun que la réparation sociale s’effectue et que l’émancipation humaine se génère. C’est par le fait de fournir le plus tôt possible des outils à chacun pour pouvoir exprimer soi-même sa propre culture qu’un apaisement individuel est obtenu. Patrice Meyer-Bisch, philosophe à l’origine de l’écriture de la déclaration de Fribourg, parle à ce sujet de ce que chacun réussisse à faire œuvre de lui-même. C’est magnifique d’utopie et à la fois si palpable et nécessaire aujourd’hui dans ce monde en pleine mutation.

Suzanne Husky, « Occuper résister cultiver », 2017 © P. Petiot
BJ – Nous entendons un bilan très positif à travers les retours des différents acteurs du territoire ; les communes, les communautés de communes, les associations, les participants… sont enchantés par ce que SILLON a réussi à apporter sur le plan des liens, des rencontres interprofessionnels, de cohésion territoriale.
Du côté de l’association, nous restons dans un bilan qui se veut toujours critique. Le but de SILLON n’est pas de poser une manifestation de plus sur un territoire où elles sont déjà nombreuses. La forme biennale (un temps fort sur un temps court qui a lieu tous les deux ans) questionne également car est en mesure de continuer à générer des formes de consumérismes culturels dans une esthétique et une géométrie proche de celle d’un festival. Il semble évident pour nous d’envisager devoir mettre en place un travail plus continu, un travail d’études, de mise en connaissances et perspectives de ce qu’est ce territoire en en définissant ses limites géographiques. Travail qui pourrait être mené pendant les deux années entre les biennales et dont SILLON se proposerait de venir en partager les fruits. Cela pourrait être à travers l’accueil de résidences aux pratiques variées comme l’anthropologie, la musique, l’agriculture et bien sûr les arts visuels ou encore à travers la mutualisation des dynamiques associatives existantes. Cette perspective implique notamment de repenser notre propre structure associative en la constituant dès le départ de manière transversale. Cela nécessiterait bien évidemment d’autres niveaux de financements et l’association doit mener une vraie réflexion sur son économie et notamment celle de la manifestation. La part d’autofinancement obligatoire et non négligeable au regard de questions éthiques comme celle de l’accès à la culture. Et à la fois se positionner fermement sur la nécessité de soutenir financièrement les artistes qui exposent leur travail en reconsidérant cette idée bien ancrée d’une perpétuelle et automatique gratuité.
BJ – Oui, bien sûr, mais dans une moindre mesure. L’œuvre de Michel François (‘Scribble’, collection de l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes) qui va rester un an dans l’église du centre de la commune de Rochebaudin permet d’acter un prolongement d’une présence artistique intéressante. Cette église est celle qui accueille l’ensemble des célébrations des villages avoisinants. Un dialogue sincère s’est noué avec la paroisse référente. L’œuvre a été installée de manière à pouvoir prendre part à cette dynamique paroissiale mais pour rendre pleinement effective sa présence, il serait intéressant d’envisager un bon accompagnement générant échanges et rencontres. De la même manière, d’autres œuvres auraient pu rester en place plus longuement comme celle de Claude Rutault dans le camping de Pont-de-Barret.

Michel François, « Scribble », 2008 (col. IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes) © P. Petiot