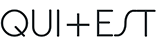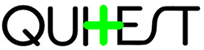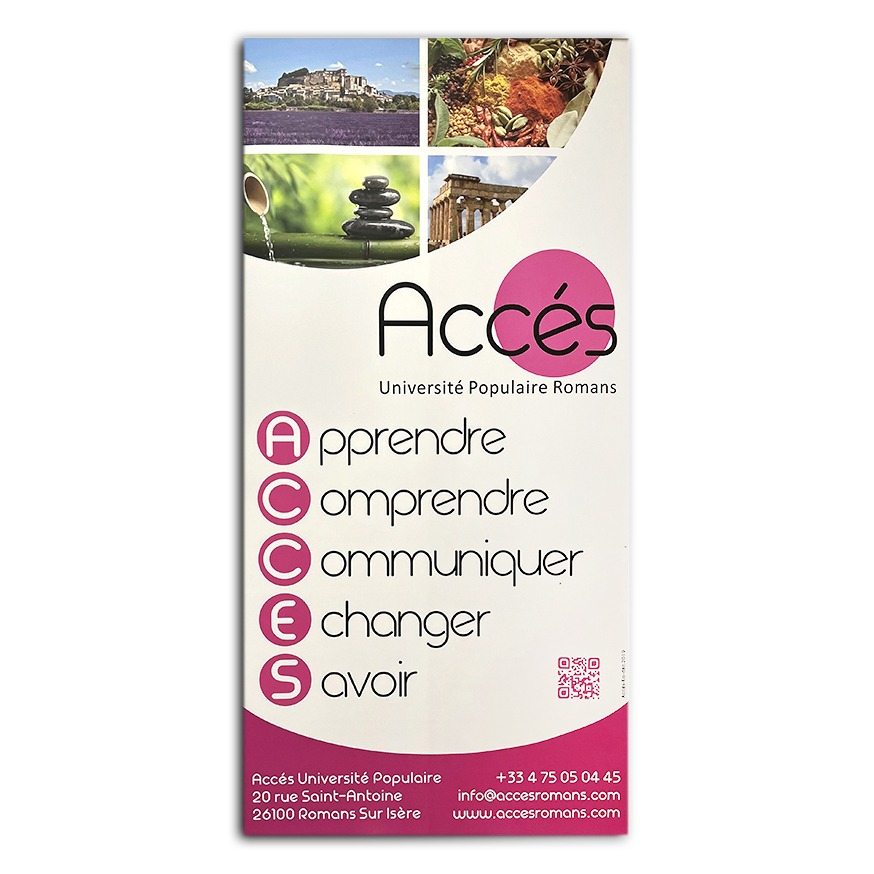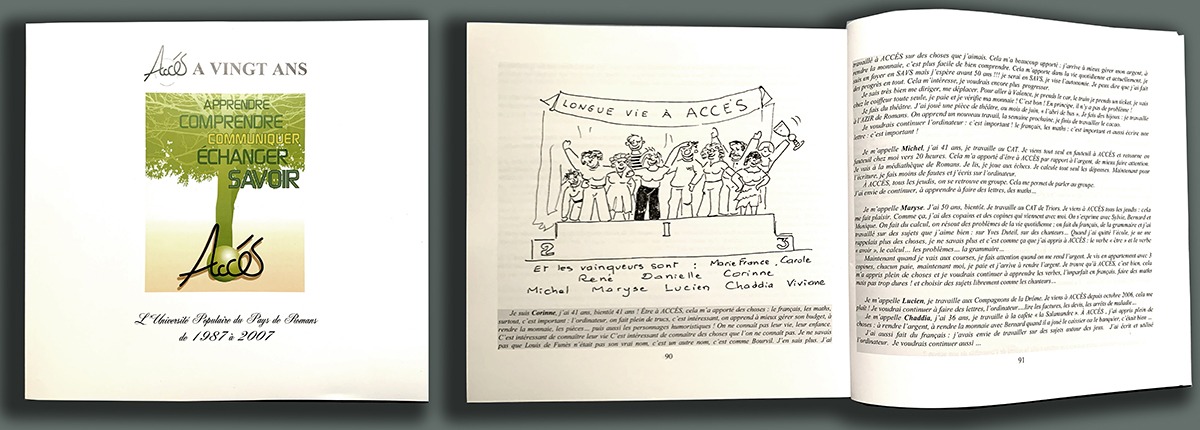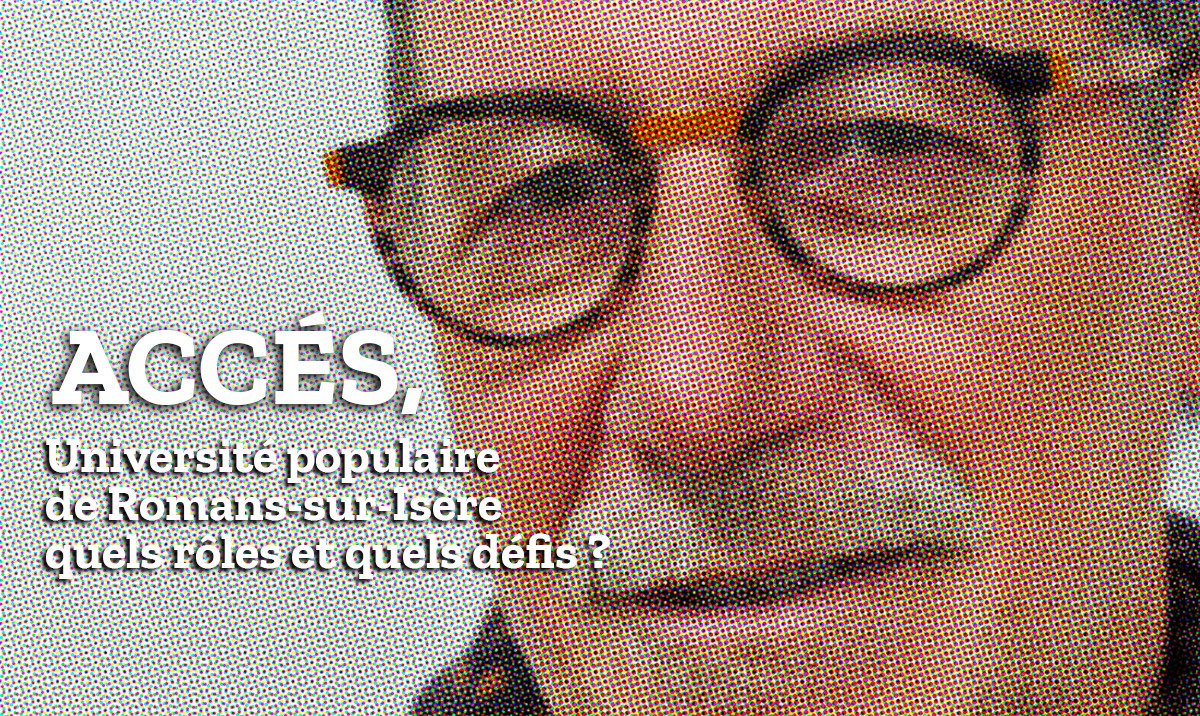
Photographie © R. Chambaud
Frédéric Pin – A la Révolution, c’est la première fois qu’est revendiquée, notamment par Condorcet, l’instruction pour tous. Pour autant il n’y a pas d’organisation qui naisse à cette époque là. Les universités populaires apparaissent fin XIXe/début XXe siècle, dans un contexte où l’affaire Dreyfus entraine des démarches collectives et la création en 1898 de la Ligue des droits de l’homme, et où est votée la loi 1901 (*) qui favorise une dynamique associative dans les mouvements militants.
Les universités populaires sont portées par des progressistes et par l’idée suivante : pour que les hommes puissent vivre l’égalité et être de bons citoyens, il faut qu’ils comprennent le monde autour d’eux et qu’on leur donne les moyens de s’instruire notamment pour ceux qui n’ont pas été à l’école. Plusieurs centaines d’UP sont créées au début du XXe siècle, mais déclinent très vite avant la Première Guerre mondiale, de même entre les deux guerres car offrir des possibilités d’instruction sur des temps de loisirs à des gens qui n’avaient pas de loisirs n’était pas opportun.
FP – Au commencement, l’objectif est d’apporter le savoir aux gens qui en ont été privés : il y a des sachants qui apportent leur savoir aux autres. Dans les années 1960-70, l’objectif ressurgit dans le champ de l’éducation populaire avec les idées de lien social, de partage de savoirs, de non hiérarchie des savoirs, de lieux d’échanges de savoirs ouverts à tous. Si certaines UP restent sur le schéma de la prépondérance de la culture académique, la majorité des UP partagent cette conception de lieu où les savoirs s’échangent.
Les principes des UP (ill. 1) sont : un lieu accessible à tous où tous les savoirs se partagent, où il n’y a pas de hiérarchie entre les savoirs : les savoirs pratiques ont autant de sens que les savoirs académiques traditionnels.
FP – A l’origine de la création de l’UP Accès en avril 1987, la SAMIR – mutuelle forte des travailleurs dans les milieux communistes et CGTistes créée en 1955 – a un rôle primordial, comme le raconte la brochure «ACCÉS a vingt ans» (ill. 2). En 1986, elle prend conscience qu’une mutuelle ne doit pas que rembourser des prestations, mais doit aussi permettre à ses adhérents d’être bien et d’accéder à toutes les formes de cultures. Alors le noyau des administrateurs de la SAMIR crée l’UP, obtient rapidement le soutien de la Ville de Romans qui leur met à disposition des locaux ; très vite il fédère d’autres personnes que les militants de la mutuelle, notamment dans le milieu des enseignants. Rapidement à côté de cette origine du monde des organisations communistes qui sont encore fortes dans les années 1980, un autre courant de militants se forme plutôt composé d’enseignants, CFDTistes, catholiques de gauche. Comme dans d’autres UP, il y a toujours ces deux courants.
FP – 60 à 70 personnes s’investissent. Une vingtaine de bénévoles se chargent de l’accompagnement de base ; une douzaine est sur l’accueil et le secrétariat ; 25 à 30 personnes sont dans les groupes qui conçoivent le programme, réfléchissent aux sujets, contactent les intervenants ; des bénévoles qui aident selon les événements ; et enfin les administrateurs.
Les thèmes ont leur propre public. Il y a un public pour les travaux manuels, cuisine, art floral, etc. D’autres, pour les voyages (ill. 3, 4), ou le patrimoine, ou les lettres et la philosophie. Le noyau dur des adhérents de 150 à 200 personnes va un peu partout ; et celui qui marche bien – de 40 à 60 personnes par séance -, est sur la géopolitique et l’actualité.
En dehors des langues, des ateliers de pratiques artistiques et des ateliers d’écriture, le programme est composé de modules d’une, deux ou trois séances, les cycles plus longs n’ont pas été concluants.
Le programme annuel propose 130 modules avec une centaine d’intervenants, dont 55% sont bénévoles.
La spécificité de l’UP de Romans est dans les apprentissages de base qu’on a développés dès le début.
Et vu le durcissement actuel pour se faire naturaliser ou pour avoir un titre de séjour, il faut prouver une certaine maîtrise de la langue, beaucoup de personnes viennent pour aller chercher la reconnaissance de l’examen. On est capable de s’adapter aux besoins de chacun, de l’illettrisme à un bon niveau initial ; les groupes de trois à cinq personnes sont accompagnés par deux bénévoles.
FP – On a des partenariats avec la Cité de la musique de Romans, L’art et la matière, le Festival de concerts de Noël à Saint-Donat, etc.
Et il y a des actions communes avec le réseau d’éduc’ pop’, comme la rencontre sur le thème « Contre les discriminations » en novembre 2024, et la table ronde « Comprendre et lutter contre les stigmatisations des quartiers populaires » avec des universitaires et des auteurs (*) accompagnée de témoignages et d’interventions de lycéens (ill. 5). Le prochain thème sera « Les jeunes et l’information ».
FP – Selon les années, il y a entre 600 et 700 adhérents. En 2024, on a touché près de 780 personnes dont 620 adhérents car on a créé des conférences ouvertes à tous les publics sans obligation d’adhérer afin de toucher de nouveaux publics.
Le nombre total de participants aux propositions d’ACCÉS est de 2300 sur l’année. Romans représente 40% et les personnes nouvelles viennent du grand territoire romanais, des communes autour de Romans : on développe une politique volontariste de propositions dans des villages avec les structures et les associations locales, comme à Mours, Génissieux, Saint-Vincent- la-Commanderie, Chatuzange-le-Goubet, Marche…
En 2025, les 11% d’augmentation que ce soit en nombre de personnes différentes ou en nombre total d’inscriptions viennent essentiellement du grand territoire romanais.
C’est contradictoire car on s’appelle ACCÉS Université Romans, ce qui est logique car nos locaux sont à Romans et on reçoit une subvention significative de la Ville ; mais on souhaite aussi se positionner comme UP de la région romano-péageoise.
FP – On a rencontré le président, Nicolas Daragon, avec l’UP de Valence pour expliquer nos objectifs et nos actions sur le territoire de l’Agglo qui a une responsabilité certaine ; mais tout de suite a été affirmé qu’il n’y avait pas de budget et que c’était de la responsabilité des communes d’aider le monde associatif. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est la mise à disposition de salles, notamment avec la nouvelle médiathèque à Romans et son auditorium en cours de construction qu’on aimerait bien utiliser.
FP – Oui, le prix peut être un frein, c’est pourquoi on a créé 15 conférences ouvertes à tous sans besoin d’adhésion, au prix de 5 €. Et tout titulaire de minima sociaux et les moins de 25 ans bénéficient du demi tarif. Mais l’élargissement se fait difficilement, d’où la nécessité de faire des partenariats avec des personnes qui travaillent avec d’autres publics : les maisons de quartier, les associations dans les villages, etc. A Romans, on a un partenariat avec toutes les associations d’éducation populaire (maisons de quartier, MJC, Romans international, Ebullition…) et on pilote des actions communes à l’automne et le festival « Des pas de côté » au printemps. Mais ce n’est pas facile car toutes ces structures ont déjà des difficultés et la commune de Romans n’apporte pas un soutien fort aux dynamiques associatives.
FP – C’est la mairie qui est venue nous chercher ; la maire avait noué un partenariat avec la fondation « Break Poverty Foundation » qui ambitionnait de trouver des fonds auprès du milieu économique et de les mettre à disposition de structures qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion. Elle proposait aussi de dupliquer le projet « Digital académie », qui accompagne des jeunes de quartier en difficulté pour faire des études. Mais la mairie, n’ayant pas les forces en interne pour gérer, s’est tournée vers nous. Cette proposition a été l’objet de débats internes, mais était aussi un champ innovant nous permettant de toucher un nouveau public de jeunes et de travailler sur l’accès aux savoirs par mode digital.
Finalement ACCÉS s’est engagé en 2019 grâce au mécénat de la fondation. Puis en 2020, le ministère de l’enseignement supérieur a lancé le projet « Campus connecté ». On a été sélectionné et depuis il nous verse 30 000 € par an qui s’ajoute aux 90 000 € de mécénat, ce qui nous permet de financer les trois salariées et les frais de fonctionnement. Le local, ancienne banque, nous est mis à disposition par la ville dans le centre ancien (ill. 6). Elle prend également en charge les fluides.
FP –L’objectif est d’accompagner des personnes qui souhaitent faire des études supérieures en ligne dans tous les domaines ; il y a plus de 5000 formations qualifiantes. On offre un lieu, un accompagnement individuel, des temps collectifs sur des sujets (méthodologie, culture générale, découverte du monde citoyen et associatif…). On touche entre 25 et 30 personnes par an, dont une ou deux personnes qui n’ont pas le BAC et qui prépare le D.A.E.U. (Diplôme d’accès aux études universitaires) pour pouvoir faire ensuite des études supérieures.
On espère que le soutien du ministère sera reconduit en 2026 et que la Ville, qui a repris en interne la recherche de mécénats auprès d’entreprises, maintienne son aide. Si le financement se tarit, on arrête car c’est lourd pour nous : cinq administrateurs s’investissent, soutiennent l’équipe des trois salariés, doivent négocier avec l’Université de Grenoble avec qui on est en partenariat, avec la Banque des territoires.
FP –L’accès aux savoirs est la condition pour que chacun soit acteur de la transformation sociale. Pour qu’il y ait transformation, il faut qu’il y ait des personnes qui s’engagent avec un minimum d’outils citoyens.
Le rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2019 (ill. 7), « L’éducation populaire, une exigence du XXIe siècle » est très intéressant car il fait un état des lieux et des préconisations pour apporter des réponses aux mutations en cours et relever les défis.
Les deux rapporteurs, Christian Chevalier et Jean-Karl Deschamps, sont intervenus à Romans ; tout en admettant qu’il est difficile de définir l’éducation populaire, ils ont rappelé les constantes toujours bien actuelles : « finalité transformative de la société ; contribuer à l’émancipation individuelle et collective ; attachement à une pédagogie active reposant sur le principe que chaque personne est porteuse de savoirs, tous étant sachants et apprenants ; reconnaissance du droit à l’expérimentation et au tâtonnement dans son rôle de laboratoire de l’innovation sociale; portage par des structures non lucratives ; attachement au développement de la qualité de vie sur les territoires ».