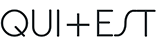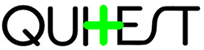À Valence à partir des années 2014 et à la suite du changement municipal (*), l’approche du patrimoine est paradoxale : d’un côté l’établissement de règlements d’urbanisme insistant sur le respect et la mise en valeur du patrimoine ; de l’autre des abandons, des démolitions de patrimoines pourtant témoins de l’évolution urbaine, des constructions nouvelles effaçant l’histoire de Valence ou défigurant des secteurs au profit d’opérations principalement privées d’une grande banalité. L’indifférence au patrimoine non prestigieux, la vision du « patrimoine-boulet » semblent être toujours ancrées dans les villes moyennes comme Valence, loin d’une approche du « patrimoine-atout », témoin d’une diversité historique, architecturale et économique, levier de cohésion sociale et de transition environnementale.
Auteure :
Chrystèle Burgard
Sommaire
I – La situation actuelle, acteurs et outils de planification
1 – Les acteurs dans le domaine du patrimoine
Aborder la place du patrimoine à Valence ces dix dernières années nécessite de rappeler le rôle des acteurs et la compétence de chacun, notamment depuis la création en 2016 de Valence Romans Agglo qui modifie le champ d’intervention des élus et des équipements patrimoniaux. La gestion et la valorisation du patrimoine sont, comme la culture, une compétence partagée entre différentes collectivités et impliquent régulièrement des actions conjointes mais dépendent aussi de la place du patrimoine dans la politique de la ville décidée par le maire (ill. 1, 2).
• La commune de Valence
Premier acteur du patrimoine, la commune a la charge de l’entretien du patrimoine dont elle est propriétaire et « doit intégrer le patrimoine public et privé dans son projet territorial, notamment au travers de sa politique d’urbanisme et de développement durable » . C’est le maire qui peut ou non orienter la politique et faire du patrimoine une priorité urbaine, économique, sociale et culturelle. Avec ses adjoints et conseillers, il définit les orientations dans les différents domaines en lien avec le patrimoine et vote le budget. Ces choix sont mis en œuvre par les Directions et les Services municipaux (*). En dehors du Théâtre de la Ville, seul le Musée de Valence reste un équipement municipal dans le domaine du patrimoine. En effet depuis 2016, différents équipements culturels ont été transférés à Valence Romans Agglo : Pays d’art et d’histoire, Médiathèque publique, Archives communales et communautaires, Conservatoire Musique et Danse, Centre du Patrimoine Arménien (*). Dans le domaine du patrimoine, cette évolution amène une modification de leur périmètre d’interventions et une orientation des actions sur un large territoire, notamment pour Pays d’art et d’histoire.
• L’État
Il définit les orientations nationales et le budget consacré au patrimoine appliqués par le ministère de la Culture (direction générale des patrimoines et de l’architecture) et sur le territoire par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) avec ses services, en particulier la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) établie à Valence et responsable de « la promotion de la qualité architecturale, patrimoniale et urbaine ».
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes (compétence partagée)
Elle est chargée de l’inventaire général du patrimoine et a pour objectif de « valoriser le patrimoine culturel des territoires : sites culturels, historiques, religieux », à travers des événements culturels et touristiques grâce à des appels à projet et des subventions.
• Le Département (compétence partagée)
Il apporte une aide à l’investissement pour des opérations concernant le patrimoine protégé et non protégé (restauration, valorisation) auprès des communes de moins de 25 000 habitants, des EPCI, des privés ; auprès de la Ville de Valence (*) au titre du dispositif « Grandes villes » avec Romans et Montélimar.
• Les associations
A Valence, aucune association n’a un rôle de préservation et de valorisation de l’ensemble du patrimoine valentinois. Seules trois associations s’intéressent à des sujets et à des périodes spécifiques : Bonaparte à Valence ; association pour la Valorisation du Patrimoine Architectural du Valentinois (AVPAV) ; Patrimoine, Culture et Histoire des Spahis (APCHS).
Décidé par le conseil municipal en 2014, le Conseil des sages (CDSV) créé en 2015 est une instance consultative qui étudie chaque année un thème.
Concernant le patrimoine naturel, plusieurs associations à l’initiative de citoyens valorisent les canaux : canaux de Valence, canaux des Malcontents, de la Grande Marquise, du Charran, des Moulins.
Implantées à Valence ou Bourg-lès-Valence, d’autres associations ont des objectifs patrimoniaux sur l’ensemble de la Drôme, bien qu’elles abordent des sujets spécifiques à Valence : Société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie de la Drôme (SAHGD) ; Association Universitaire d’Etudes Drômoises (AUED), Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme (SSMAD) ; Mémoire de la Drôme ; Fondation du patrimoine.
Spectateurs plus qu’acteurs ? Bien qu’au niveau national, les citoyens selon Fabien Van Geer participeraient « plus qu’autrefois à la définition et à l’identification de leur patrimoine », à Valence il n’y a pas de réelle instance qui fasse le lien entre les attentes et les besoins des citoyens à l’occasion de chaque projet concernant le patrimoine et qui permettrait une appropriation et une mobilisation autour d’un sujet, car « un projet patrimoine ne se construit pas seul » comme le constate la Fondation du patrimoine.
Le peu de place accordée au milieu associatif dans le domaine du patrimoine est mis en évidence dans la répartition des subventions en fonctionnement dans le cadre du budget principal 2025 de la Ville de Valence. Sur 5 040 198 € alloués aux associations, seuls 268 010 € (5,32 %) sont consacrés à la Culture dont 13 990 € spécifiquement au patrimoine (0,27% du budget global) répartis ainsi : Mémoire de la Drôme (11 960 €), Bonaparte à Valence (1380 €), Société d’archéologie, d’histoire et de géographie de la Drôme (400 €), Études drômoises (250 €).

2 – Valence vue du pont Mistral, 2025 © R. Chambaud
2 – Des outils de gestion et de planification urbaine avec des objectifs patrimoniaux
• Promouvoir la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Valence (PLU).
Dans le centre-ville (Zone UA), le PLU (*) souligne : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité en ce qui concerne les gabarits, les séquences urbaines, les rythmes horizontaux et verticaux » (*).
• « Valoriser l’identité valentinoise par la protection patrimoniale » : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
• « Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager » : Programme Action cœur de ville (ACV).
Avec trois autres villes dans la Drôme, Valence s’est engagée dans ce programme porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui vise à « améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement de leur territoire » et pour qui « le patrimoine bâti constitue aussi une réserve de valeur écologique, sa restauration et son réemploi favorisant le recyclage urbain ».
• Affirmer « Valence comme Ville d’Art et d’Histoire » : Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Parallèlement à la révision du PLU, la Ville a entrepris en 2020 l’élaboration d’un SPR, validé en 2023 par le Ministère de la Culture. Outil « simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire », il se substitue aux AVAP, ZPPAUP et secteurs sauvegardés, et a comme objectifs : « affirmer et conforter la reconnaissance de Valence comme Ville d’Art et d’Histoire ; connaître les outils pour ne pas figer le patrimoine dans son histoire ; combler le besoin d’une réglementation opérationnelle et dynamique ». Après le diagnostic patrimonial détaillé, il reste à finaliser le règlement.
3 – Des actions modérées de protection, de restauration et de valorisation des patrimoines
Différentes opérations de protection, de restauration et de valorisation de patrimoines ont été réalisées par la Commune, l’État ou des privés.
• La protection et la labellisation d’édifices
Seuls quatre édifices, dont un du XXe siècle, ont été inscrits (et non classés) au titre des Monuments historiques depuis 2014 : Ancienne abbaye de Saint-Ruf-hors-les-murs (XIIe-XVe siècles) : inscrit MH en 2014 / Domaine de Murat-Fontlozier (XVI-XIXe siècles) : inscrit MH en 2016 / Hôtel de ville (1894) : inscrit MH en 2018 / Monument aux morts (1923/1929) : inscrit MH en 2019.
Aucune démarche de labellisation « Architecture contemporaine remarquable » n’a été faite depuis 2003 malgré la présence d’architectures emblématiques du XXe siècle comme la piscine Tournesol ou le silo à grains démoli en 2023.
• La restauration et la reconversion du patrimoine
Bien que soit élaboré en 2017 un « Schéma directeur de préservation et de valorisation du Patrimoine historique de la ville » (*) par D. Repellin, architecte en chef des monuments historiques, peu de restaurations de patrimoine importantes appartenant à la Commune ont été entreprises en dehors de l’Hôtel de ville (ill. 3). D’autres édifices ont été restaurés par l’État (cathédrale, préfecture, gare) ou des privés (Maison Mauresque, ill. 4). En outre le programme de rénovation de l’habitat et des façades malgré les aides de la Ville ne semble pas avoir porté ses fruits. Seule reconversion notable, la caserne Latour-Maubourg transformée en médiathèque par l’architecte Rudy Ricciotti en 2021 qui a réalisé un simple volume vitré devant l’ancienne façade (ill. 5).
• La reconnaissance de nouveaux patrimoines
Avec l’élargissement de la notion de patrimoine en France et plusieurs problèmes à Valence (*), la stratégie municipale s’est modifiée ; de nouveaux domaines apparaissent soit par nécessité environnementale, soit pour des raisons d’attractivité.
- Patrimoine naturel : dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, plusieurs actions sont conduites : Agenda 21 en 2019 avec l’objectif de planter 10 000 arbres d’ici 2026 ; deux recensements d’arbres en 2021 avec la désignation de 324 arbres remarquables ; réaménagement du parc de l’Epervière en 2016 en conservant des essences existantes, en favorisant la biodiversité. Si la végétalisation est affichée comme une priorité, elle est pensée avec une approche quantitative et non qualitative notamment par rapport aux usages sociaux et à la composition urbaine.
- Patrimoine gastronomique : promouvoir la gastronomie, notamment avec le projet de « Cité gourmande », est l’ambition de la municipalité; cependant l’approche est avant tout commerciale, touristique et économique, et non à travers les dimensions patrimoniales et culturelles (savoir-faire et techniques, recettes et produits, coutumes et légendes…), à la fois régionales et en lien avec les diasporas présentes à Valence.
II – L’incohérence entre objectifs patrimoniaux et opérations
Malgré les objectifs affirmés de protection et de mise en valeur du patrimoine, on ne peut que constater les écarts entre les intentions et les interventions réalisées par la Ville, des opérateurs publics ou privés, pourtant dans des secteurs sous la responsabilité de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de la Drôme dont les missions sont en particulier « Conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité ».
Dans le cas de nouvelles constructions, le PLU recommande : « La plus grande simplicité est à rechercher. Il n’est pas recommandé de plagier des modénatures anciennes mais d’être attentif à la composition de la façade (rythmes, plein/vide) et à la qualité des détails architecturaux, qui pourront être enrichis avec des éléments de décor contemporain » (*).
1 – Des démolitions de l’histoire et de l’identité de Valence
Des édifices et des vestiges des activités artisanales, industrielles, sociales qui ont fait l’histoire et la singularité de la ville ont disparu ou sont transformés maladroitement comme la Maison d’arrêt (avenue de Chabeuil) démolie en 2019 malgré l’intérêt de la rotonde et les possibilités de reconversion, le Silo à grains construit dans les années 1930 démoli en 2023 bien qu’il fasse partie des cinq silos « cathédrales de la Drôme » de l’architecte G. Salomon (1893 – 1963).
Dans le centre ancien, sont détruits des îlots comme celui de la mairie annexe et de l’ancienne médiathèque (ill. 7) et deux autres malgré l’objectif du PLU : « Favoriser les rénovations du bâti existant en les associant à des interventions architecturales créatives » (*).
- Ilot Chauffour (entre rue Jonchère et rue du Jeu de Paume), constitué d’habitations anciennes typiques du centre ancien, cet ilot est détruit en 2024 pour une opération VALRIM comprenant des logements, des bureaux et des commerces, déstructurant le tissu urbain (ill. 8, 9).
- Ilot Louis Le Cardonnel (entre les places L. Le Cardonnel et C. Huguenel) : l’ancien Petit séminaire qui a accueilli la bibliothèque et le musée au XIXe siècle, a été en partie démoli ainsi que les découvertes archéologiques (*), pour construire une résidence Séniors « nouvelle génération » (*) qui laisse perplexe devant la prise de site, l’intégration au bâti existant, le traitement architectural (ill. 10, 11, 12).
- Parvis de la cathédrale et rempart de la cité : dans le cadre du projet de « Cité gourmande » dans la basse ville, sont entrepris des travaux de requalification du parvis (Maître d’ouvrage : État/DRAC) et la construction d’un escalier monumental (Maître d’ouvrage : Ville) sans opération d’archéologie préventive alors que sont présents de nombreux vestiges antiques et médiévaux dont ceux du groupe épiscopal primitif de Valence (Ve siècle), du baptistère paléochrétien, du rempart , de l’église canoniale Saint-Étienne (Xe siècle), etc.
Au-delà de la destruction déplorable de vestiges archéologiques, se rajoute la construction d’un escalier monumental pour un montant de 3,2 millions d’€. Conçu à partir d’un croquis réalisé au XIXe siècle par l’architecte Bailly, cet escalier est un véritable pastiche de celui du Parc Jouvet mais inapproprié au site de la basse ville, hors normes d’accessibilité, et loin d’une « architecture créative » .
2 – Des patrimoines abandonnés
Plusieurs sites et édifices sont partiellement délaissés ou abandonnés malgré leur valeur patrimoniale :
- Maison des Têtes : édifiée au XVIe siècle, elle est restaurée après son acquisition par la Ville en 1980 et accueille au RCH en 1996 le service Valence Ville d’Art et d’histoire. Cependant le grand salon au 1er étage datant du XVIIIe/XIXe siècle est laissé à l’abandon alors que sa restauration permettrait de développer l’histoire de Valence (ill. 15).
- Maison Dupré-Latour(rue Pérollerie) : cet ancien hôtel particulier du XVIe siècle classé MH en 1927 est propriété de la Ville depuis 1972. Les intérieurs restent inoccupés et ne sont toujours pas restaurés alors que cet édifice Renaissance contribuerait à « affirmer et conforter la reconnaissance de Valence comme Ville d’Art et d’Histoire » (SPR) (ill. 16).
- Parc Saint Ruf : fermé depuis 2018 pour risque d’affaissement, le parc conserve la porte du palais abbatial, siège de la préfecture de la Drôme détruite en 1944. Occupé auparavant par un espace-jeux pour enfants et un vignoble, il est l’objet de diagnostics et pourrait être réouvert comme site d’intérêt archéologique, historique et paysager.
- Côtes, escaliers, rues entre la basse ville et le centre ancien : les côtes Sainte-Ursule, Sylvante, Saint-Martin…, les rues Pérollerie, Saint-James, Sabaterie… sont peu entretenues et peu restaurées alors qu’elles pourraient contribuer à faire le lien avec la basse ville et mettre en valeur l’histoire et la structure urbaines.
- Fleuve Rhône : ce patrimoine fluvial et naturel est nié depuis la construction de l’A7. Seul le site de l’Épervière joue un rôle d’interface entre le Rhône et Valence, mais sans approche patrimoniale et sans possibilité de réappropriation du fleuve par les habitants et les cyclistes alors que déjà une simple liaison le long du Rhône avec le parc Girodet à Bourg-Lès-Valence pourrait être réalisée, mais la ViaRhôna ne passerait pas par la future « Cité gourmande » dans la basse ville… Bien que le PLU prône la « requalification des berges et l’émergence d’un nouveau rapport des valentinois au Rhône », des murs anti-bruit de 3 et 5 mètres de haut (ill. 17) vont être construits le long de l’A7 (32 millions d’€) accentuant encore plus la coupure avec le fleuve.
- Toueur l’Ardèche (ill. 18) : construit en 1896, témoin de la batellerie fluviale du XIXe siècle, il est déplacé en 1983 au port de l’Epervière et depuis complètement délaissé alors qu’il pourrait être renfloué et apporter une dimension patrimoniale au port et être un atout touristique.
- Piscine Tournesol (ill. 19) : D’une grande invention technique et esthétique, cette piscine conçue « en série » par l’architecte Bernard Schoeller est réalisée sur le quartier de Valence-le-Haut en 1975. Elle est menacée de destruction alors qu’elle est représentative de l’architecture du XXe siècle et qu’elle pourrait être réhabilitée en équipement de quartier sportif (en lien avec les tennis) ou culturel.
« Le patrimoine a-t-il fait son temps ? »
Si le patrimoine a été une ressource pour la ville et un terrain pour des projets innovants fin XXe/début XXIe siècle, il est ces dernières années tombé dans l’indifférence malgré les nombreux outils de gestion et de planification urbaine et les intentions patrimoniales affirmées : abandons, destructions, absences d’instance citoyenne, de publications scientifiques en dehors des deux revues, Revue Drômoise et Etudes drômoises, et de grandes expositions temporaires sur des sujets historiques ou archéologiques sur Valence, la dernière « De mémoires de Palais » datant de 2006 au musée de Valence (ill. 20).
Il ne suffit pas d’élaborer un récit triomphaliste et de mobiliser le patrimoine au seul service de l’attractivité alors que des programmes comme « Action cœur de ville » ou « Petites Cités de Caractère » ne cessent de réaffirmer : « Le patrimoine, héritage de l’histoire de la cité, révèle sa force de cohésion et son pouvoir fédérateur […] Le projet patrimonial est d’abord la traduction d’un projet politique. Il induit de hiérarchiser, prioriser, et choisir ».
A Valence, le patrimoine aurait-il fait son temps ?
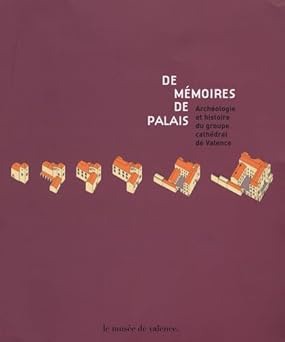
20 – Catalogue de l’exposition « De mémoires de Palais », musée de Valence, 2006.
Tous les articles de la série
« Le patrimoine à Valence, approche et évolutions de l’après guerre à nos jours »