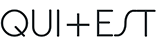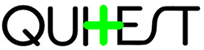La place des gestes et de l’expérimentation, le processus de création, le statut de l’œuvre d’art et de son auteur habitent les recherches de Linda Sanchez et Baptiste Croze qui inlassablement réinventent le réel. Chacun conduit sa propre démarche artistique et tous deux collaborent sur certaines productions comme l’installation « Roulé-boulé » présentée à la Bourse du Travail à Valence (*) ou sur des projets de médiation comme la résidence-mission en cours dans le sud de la Drôme. C’est dans le contexte du projet, le ʺTerritoire comme carnet de créationʺ, que les deux artistes dialoguent autour de la conception de leur travail et de l’approche des publics bousculant délicatement la conception traditionnelle de l’œuvre d’art et de l’artiste.
Auteur : Q+E (C. Burgard)
Entretien avec
Linda Sanchez
& Baptiste Croze
à Valence 12 /2021
LS – Il est important de revenir sur l’appel à candidature de la résidence dont la formulation comportait déjà de beaux partis pris qui rejoignaient nos préoccupations. Une résidence-mission est parfois compliquée car elle peut ressembler à une suite de prestations dédiées aux publics des structures culturelles, éducatives ou médicales… D’ailleurs les résidences-missions s’adressent généralement davantage aux spectacles vivants. Faire ce type de projet nous a posé les questions de réalisation, du faire, des matériaux : comment on déplace notre pratique d’artiste sur un territoire alors que nous sommes plutôt dans la sculpture et dans un travail d’atelier ? Et quels sont les enjeux et les possibilités de créer du lien avec les habitants ? On a construit le dossier de candidature en prenant du temps pour aller chercher dans notre travail ou dans les »phases » du travail ce qu’on pourrait convoquer sur ce territoire pluriel et composé.
BC – Une résidence-mission cerne un public, par exemple, celui d’un hôpital ou d’une école. Ces appels à projets formulés en taux horaires et convoquant les habitants se sont beaucoup développés depuis une quinzaine d’années. Ici, cette résidence-mission tentait de parler d’un paysage, d’élaborer des idées liées au paysage à la rencontre de publics plus éloignés. On s’est demandé alors : qui fabrique le paysage et qui n’a pas le temps d’aller voir de l’art ? Ce sont les gens qui font des gestes, ceux qui travaillent en Zone Industrielle, en Zone Agricole, dans les magasins, les artisans, les agriculteurs, etc. Un des vecteurs pour nous, ce sont les gestes et le partage de gestes : c’est notre point de départ.
LS – Ce partage ne s’inscrit pas que dans le langage, la manière dont les personnes se représentent ou un récit qu’on pré-écrirait. On a plutôt évoqué le sensible, la complicité, l’empathie avec des personnes qui connaissent les matières, les gestes, les machines, les outils et les techniques. On s’est également interrogé sur comment on crée un dispositif pour créer une expérience ? Comment des métiers qui semblent très lointains – type un boucher ou un forgeron – peuvent avoir des concordances, des résonnances avec nos gestes d’artistes ? On avait proposé l’exemple du métier de boucher qui d’une certaine manière est concerné par les gestes d’un sculpteur dans la découpe, le filigrammage, les questions de poids et de masse, de répétition des gestes, dans la mollesse de la matière, dans sa transformation…
BC – Et ce territoire particulièrement regorge de métiers et de savoir-faire inédits, plus proches et plus hybrides que dans les grandes villes. Le voir en train de se faire, les effets de notre implication sur le réel sont plus perceptibles ici. C’est également mettre en commun des choses qu’on fait déjà. Et déplacer et retrouver un réseau dynamique dans lequel on travaille déjà. Je pense aux réseaux d’adresses qui nourrissent nos techniques et nos travaux plastiques (fournisseurs, collectes et seconde-main, location de matériel, pièces et techniques d’extractions, …)
LS – Par exemple depuis des années, Baptiste collecte des centaines d’objets – vases, skis, bidons, etc. – et développe une connaissance presque anthropologique des milieux. C’est un travail qui est autour de la sociologie des objets ou plutôt de la chaîne de vie des objets. Ce sont surtout des objets usuels de consommation mais qui en disent long sur nos intimités, mais aussi sur des régions comme les ʺSculptural studiesʺ ou ʺLes formes donnéesʺ, deux œuvres évolutives de Baptiste, qui captent des aspects vernaculaires car elles sont faites sur un territoire ; elles ne disent pas directement quelque chose du territoire mais elles puisent dedans.
Venir en résidence, c’est redistribuer, remettre en réseau. On a une sorte de grille dynamique qui s’applique et s’adapte à un territoire donné. Il s’agit de partir de notre travail et de ses connexions avec des adresses, boutiques, industries… pour créer un projet.

Installation « Roulé-boulé » à la Bourse du Travail, Valence, 2021 © JPBos
BC – Je suis né à Valence, donc je connais un peu la région. Et on a fait beaucoup de repérages par internet. Au départ, notre proposition était très large, remontant jusqu’à Hauterives et descendant jusqu’aux Baronnies. Quand on est venu sur place, et après trois semaines de repérages, on pensait pouvoir connecter les villages, les différents territoires de la Drôme mais on a dû se recentrer sur Valaurie, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Grignan. Et surtout, on a rencontré les personnes du musée de la Mémoire agricole à Montjoyer et là, se sont cristallisées beaucoup de choses que nous avions projetées. Pour parler du global, on est parti du local. Construire des relations, se faire accepter, c’est plus long qu’intervenir. On a rencontré des gens à qui on n’allait pas apprendre à faire mais avec qui on pouvait partager des complicités.
BC – Aujourd’hui, notre projet de résidence s’oriente principalement sur deux directions : la collaboration avec les bénévoles du musée de la Mémoire agricole à Montjoyer et le projet dans l’espace public des images vacantes. L’ensemble de ce territoire est recouvert de panneaux publicitaires ou indicatifs au bord des routes, servant aux pépiniéristes, maraîchers, revendeurs, vignerons, gîtes … Ils marquent particulièrement ce territoire mais la nouvelle loi sur la pollution visuelle les a interdits et il reste aujourd’hui les ossatures des panneaux encore visibles ici et là au bord des routes, à l’entrée des villages.
On s’est posé la question de comment encore parler et faire du lien. On a réinvesti temporairement ces panneaux avec des images que nous avons produite et ensuite encollé en « dos bleu ». Ces images sont des photos et des prises de notes formelles par rapport à nos regards de sculpteurs : ce sont des textures, des organisations particulières, minérales, des structures désorganisées, des morceaux d’outils, des plasticités du paysage que nous regardons. C’est des détails du territoire qui existent moins dans la manière dont il se représente que dans sa structure interne, sa formation, son historique.
LS – Pour les réinvestir, il a fallu rencontrer les propriétaires et négocier auprès des habitants, des mairies, des associations. Un travail de repérages, d’enquête et de rencontres. On aimerait que les habitants poursuivent le projet et que ce ne soit pas seulement nos images et nos signatures d’artistes car les contenus ne nous appartiennent pas. Ça devient une sorte de programmation éclatée à organiser entre les villes, sur les routes. Une sorte de narration et on verra si le projet prend son autonomie.
Ce projet caractérise bien nos partis pris artistiques ; un rapport non autoritaire aux matériaux et aux terrains, dans ces jeux d’assemblages, de déplacements, de réactivations. Là, ça se déplace vers un projet plus structurel et collectif. L’idée est aussi qu’il y ait un détail de Roussas à Valaurie, de Valaurie à Saint-Restitut, de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Roussas. Et c’est dans cette interaction géographique que ça existe avec les habitants.

Images Vaccantes, Place du puit, Valaurie © Linda Sanchez & Baptiste Croze

Images Vaccantes, Place du puit, Valaurie © Linda Sanchez & Baptiste Croze
LS – Ce projet est une rencontre autour de ses collections incroyables et de cette communauté inédite d’anciens paysans, de mécaniciens, de bricoleurs… Ils et elles ont rassemblé un ensemble d’outils, d’objets et de machines qui racontent la fabrication du paysage en même temps qu’une histoire de l’invention de techniques. Ils réparent, enquêtent, spéculent et déduisent sur l’histoire des gestes et des usages. Et ils le racontent. Ce qui génère des récits et un vocabulaire très riche du Faire. Un patrimoine vivant.
BC – Il y a de nombreux points communs entre travailler dans un champ et dans un atelier, beaucoup de déductions, d’empirisme, de moyens du bord. On est confronté aux mêmes situations de nécessité concrète, d’absurdité parfois. L’expérimentation, l’enquête, l’ajustement sont des méthodes qu’on partage. On est toujours dans l’écologie et l’économie du travail et de la matière.
LS – On a reçu un super accueil. En écoutant, en regardant, en passant du temps ensemble et en revenant les mercredi et dimanche on a construit une complicité. Ensemble on a rallumé la forge, coulé des fils à plomb, des balles et des formes orfèvres. On a aiguisé des lames, tourné des formes en plâtres autour d’outils tranchants. On a mesuré et reporté des formes convexes et concaves. On a imbriqué des bidons dans des faucilles, des vases dans des jougs, des enclumes de cordonnier dans des serpes. On a comparé des échelles et des gabarits. On a testé des surfaces de ponçage et éprouvé la texture sonore de la surface calleuse de nos mains… Et pendant qu’on faisait nos activités les visiteurs du musée nous regardaient faire. Ça a généré pas mal de belles conversations.
BC – Avec toujours la place et le trace de la main au centre, on a travaillé dans un aller-retour et un commun. Un processus qui nous a tous déplacé dans nos représentations et nos positions.
LS – Cet appel à projet nous a beaucoup intéressé parce qu’il y avait quelque chose à inventer et à déplacer. La nature de nos travaux aussi évolue et trouve davantage sa place dans ce type de projets. Par exemple le projet Roulé-boulé, où l’on collecte des balles, des ballons rejetés par la mer Méditerranée est une expérience collective. Elle est réalisée en équipe, avec des étudiants, des amis, des habitants, des intervenants…Dans cette résidence-mission, il y avait cette idée de déplier un peu plus, de ralentir, de mettre en forme moins les œuvres que le travail, le faire, la mise en place, l’empirisme, le prisme du regard et de la tension qui se crée et se construit à ce moment-là. La trame de la résidence se poursuit car Angle et la Maison de la Tour nous ont invités pour une exposition de restitution l’année prochaine.
BC – Dans le cadre de la résidence-mission, la question des publics n’est pas abordée de la même manière selon nos partenaires. Pour nous, elle se joue autrement. On peut quantifier les 300 personnes qu’on a accueilli au musée de la Mémoire agricole avec l’association pendant les Journées du patrimoine, les 110 personnes qui sont venues au bureau de vote de Valaurie pour les élections départementales et à qui on a demandé de voter l’image encollée et avec qui on a échangé. En revanche, c’est plus difficile de compter les personnes qui regardent les panneaux sur les routes… Mais pour les institutions, notre approche des publics est plus déroutante et moins traditionnelle que le comptage d’élèves…
LS – On voulait faire des formes autonomes comme le projet des panneaux ; ça ne convoque pas un public autour d’un atelier mais il a une justesse en termes de projet artistique, de regard. On invite un groupe d’habitants à chaque nouvelle installation… La résidence-mission pose la question : comment faire des choses et impliquer les personnes sans être dans un rapport de prestation et d’être dans une justesse et une honnêteté artistique ?
BC – Il y a les questions de comptabilité des publics mais aussi de représentations du territoire. D’autres interrogations apparaissent : quelles sont les limites du territoire ? Valence ne fait pas partie du périmètre de la résidence-mission, ni la ViaRhôna, ni une commune près de Crest … mais quand on parle des usages, des représentations, quels sont les limites, les seuils, les chevauchements ? Du point de vue du vivant, cela n’a aucun sens.
Entrevue le 23 septembre 2021, Valaurie

Journées du patrimoine 2021, Musée de la mémoire agricole © L. Sanchez & B. Croze